 George Vulturescu, Les Pierres du Nord, recueil bilingue, traduit du roumain par Jean Poncet, encres de Pierre Guimet, Jacques André éditeur, 2018
George Vulturescu, Les Pierres du Nord, recueil bilingue, traduit du roumain par Jean Poncet, encres de Pierre Guimet, Jacques André éditeur, 2018
Au départ, on pourrait croire à de la poésie autobiographique, soutenue par le caractère narratif des vers qui s’allongent au fil des souvenirs, des évocations du village, de la nature, des personnages du passé, des fêtes et des légendes de la campagne… Et les deux leitmotive qui parcourent le recueil, qui en forment même l’ossature, tendraient à le confirmer : « l’Œil Aveugle » (cet œil que George Vulturescu perdit accidentellement à l’âge de six ans) et les « Pierres du Nord » (Tireac, le village natal, se situe tout au nord-ouest de la Roumanie, près de Satu-Mare).
On pourrait le croire. Mais derrière ces détails, au-delà des apparences, se développent d’autres visions, se détachent d’autres éléments, et la poésie est là pour les révéler, pour les mettre au monde, en des images encore inexplorées :
« Et puis ce fut le matin…
et un œil doutait de ce qu’il voyait :
il y avait mille pierres et au-dessus d’elles mille autres pierres
semblables à des vaches maigres
qui mangent les vaches grasses de la Genèse. »
Images pleines, audacieuses, en harmonie avec les encres de Pierre Guimet, saturées ou déliées, suggestives ou abstraites. Et il y a le mystère de la création. Le poème est un monde fait de mots et de lettres qui sont de véritables éléments naturels :
« Les lettres sont-elles comme des pierres
sous le pied ? Combien de temps peux-tu marcher
sur ces pierres ? Ne s’enfoncent-elles pas
dans le blanc des pages quand tu les lis ? »,
« et les poèmes, lettre après lettre, sont un champ de bataille. ».
Comme l’annonce un titre : « Le Devoir d’une lettre est d’obscurcir le sens du mot ».
Le poète est à la fois témoin, scribe, créateur et gardien de ce monde ; c’est sa raison d’être :
« Je claque des dents
et je lis le nom du fou que je suis
gravé par les éclairs sur les Pierres du Nord
je me tiens à côté de leurs monogrammes tel le gardien
du pouvoir monastique des hiéroglyphes. ».
Les Pierres du Nord n’est pas un simple recueil poétique. C’est ce qu’on appelle un « beau livre », dans toutes ses dimensions : les textes, les illustrations, le format, la disposition, la mise en page qui cache parfois, sous le pli des feuillets, d’autres textes et d’autres illustrations… Un grand travail d’édition, qui vient enrichir la collection « roumaine » de l’éditeur Jacques André : les recueils bilingues de Lucian Blaga (Les poèmes de la lumière, Les pas du prophète), Maman Univers de Vasile George Dâncu – tous dans les belles traductions de Jean Poncet –, Survivre malgré le bonheur de Radu Bata, et d’autres ouvrages annoncés.
Voir les publications "roumaines" de Jacques André ici
Jean-Pierre Longre

 Vasile George Dâncu, Maman Univers / Universul Mama, traduit du roumain par Jean Poncet, Jacques André éditeur, 2018
Vasile George Dâncu, Maman Univers / Universul Mama, traduit du roumain par Jean Poncet, Jacques André éditeur, 2018  Jacques Baujard, Simon Géliot, Codine, d’après la nouvelle de Panaït Istrati, La boîte à bulles, 2018
Jacques Baujard, Simon Géliot, Codine, d’après la nouvelle de Panaït Istrati, La boîte à bulles, 2018  Marin Mincu, Journal de Dracula, traduction du roumain, avant-propos et notes de Dominique Ilea, Xenia, 2018
Marin Mincu, Journal de Dracula, traduction du roumain, avant-propos et notes de Dominique Ilea, Xenia, 2018 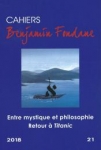 Cahiers Benjamin Fondane
Cahiers Benjamin Fondane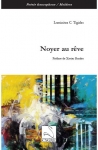 Luminitza C. Tigirlas, Noyer au rêve, préface de Xavier Bordes, Éditions du Cygne, 2018
Luminitza C. Tigirlas, Noyer au rêve, préface de Xavier Bordes, Éditions du Cygne, 2018 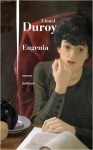 Lionel Duroy, Eugenia, Julliard, 2018
Lionel Duroy, Eugenia, Julliard, 2018 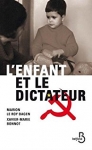 Marion Le Roy Dagen, Xavier-Marie Bonnot, L'enfant et le dictateur, Belfond, 2018
Marion Le Roy Dagen, Xavier-Marie Bonnot, L'enfant et le dictateur, Belfond, 2018 
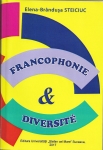 Elena-Brânduşa Steiciuc, Francophonie & diversité, Editura Universităţii « Ştefan cel Mare » Suceava, 2017.
Elena-Brânduşa Steiciuc, Francophonie & diversité, Editura Universităţii « Ştefan cel Mare » Suceava, 2017.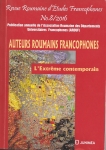 Présidente de l’ARDUF (Association Roumaine des Départements Universitaires Francophones),
Présidente de l’ARDUF (Association Roumaine des Départements Universitaires Francophones), 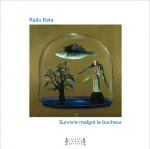 Radu Bata, Survivre malgré le bonheur, Jacques André éditeur, 2018
Radu Bata, Survivre malgré le bonheur, Jacques André éditeur, 2018 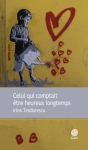 Irina Teodorescu, Celui qui comptait être heureux longtemps, Gaïa, 2018
Irina Teodorescu, Celui qui comptait être heureux longtemps, Gaïa, 2018  Gellu Naum, La Voie du Serpent, préface et traduction du roumain par Sebastian Reichmann, Non Lieu, 2017
Gellu Naum, La Voie du Serpent, préface et traduction du roumain par Sebastian Reichmann, Non Lieu, 2017  Un vrai poète, oui, pour rendre l’atmosphère, les tonalités, les couleurs d’un recueil qui nous fait parcourir la poésie de Gellu Naum de 1968 à 2004, en dix étapes : Athanor (1968), L’Arbre – Animal (1971), Mon père fatigué (1972), Poèmes choisis (1974), La description de la tour (1975), L’autre côté (1980), La rive bleue (1990), La face et la surface (1994), Ascète à la baraque de tir (2000), La voie du serpent (2004), qui donne son titre au volume avec, paradoxalement, seulement deux fragments. Ce parcours manifeste une belle diversité, dont Sebastian Reichmann suggère les grandes lignes dans sa préface, une diversité qui n’exclut pas l’unité garantie par le souffle surréaliste (ou post-surréaliste, comme on voudra) qui anime les vers, les versets, les proses. Souvent affleurent l’écriture automatique et les images surprenantes (« le ciel se remplit de taureaux », « les cheveux défaits parmi les épées et fractions »), le réel se mêle au rêve (ce qui répond parfaitement à la fusion réalisme/onirisme définie par André Breton) : il y a des « statues aux oreilles enterrées dans le sable », le « crépuscule des mots » et le mouvement perpétuel ne sont pas incompatibles avec la recherche d’un financement, et les souvenirs parisiens surgissent de la mémoire consciente ou inconsciente (le Dôme, les anciens amis, des « garçons admirables » qui veulent « briser [une porte] avec leurs viscères »). Rêves (voire « arbres rêveurs »), apparitions (de personnes réelles parfois), visions fantastiques (« un tunnel au centre de la ville / qui ne menait jamais nulle part » ou « les maisons [qui] volaient dans les airs ») hantent les pages du livre, où l’on rencontre aussi la bien-aimée Zenobia, personnage du fameux « rhoman ».
Un vrai poète, oui, pour rendre l’atmosphère, les tonalités, les couleurs d’un recueil qui nous fait parcourir la poésie de Gellu Naum de 1968 à 2004, en dix étapes : Athanor (1968), L’Arbre – Animal (1971), Mon père fatigué (1972), Poèmes choisis (1974), La description de la tour (1975), L’autre côté (1980), La rive bleue (1990), La face et la surface (1994), Ascète à la baraque de tir (2000), La voie du serpent (2004), qui donne son titre au volume avec, paradoxalement, seulement deux fragments. Ce parcours manifeste une belle diversité, dont Sebastian Reichmann suggère les grandes lignes dans sa préface, une diversité qui n’exclut pas l’unité garantie par le souffle surréaliste (ou post-surréaliste, comme on voudra) qui anime les vers, les versets, les proses. Souvent affleurent l’écriture automatique et les images surprenantes (« le ciel se remplit de taureaux », « les cheveux défaits parmi les épées et fractions »), le réel se mêle au rêve (ce qui répond parfaitement à la fusion réalisme/onirisme définie par André Breton) : il y a des « statues aux oreilles enterrées dans le sable », le « crépuscule des mots » et le mouvement perpétuel ne sont pas incompatibles avec la recherche d’un financement, et les souvenirs parisiens surgissent de la mémoire consciente ou inconsciente (le Dôme, les anciens amis, des « garçons admirables » qui veulent « briser [une porte] avec leurs viscères »). Rêves (voire « arbres rêveurs »), apparitions (de personnes réelles parfois), visions fantastiques (« un tunnel au centre de la ville / qui ne menait jamais nulle part » ou « les maisons [qui] volaient dans les airs ») hantent les pages du livre, où l’on rencontre aussi la bien-aimée Zenobia, personnage du fameux « rhoman ». Journal
Journal