 Cornelia Petrescu, Le sagittaire, Marc Pessin, Encres, Le verbe et l’empreinte, 2016
Cornelia Petrescu, Le sagittaire, Marc Pessin, Encres, Le verbe et l’empreinte, 2016
Présentation :
« Les poèmes de Cornelia reflètent des tensions contradictoires, tantôt vers une relation intime, profonde, avec la langue et le pays d’adoption, tantôt vers cette voix qui refuse de se taire, qui l’appelle du tréfonds de ses racines et qui n’est pas sans rappeler l’aveu d’un autre créateur roumain déraciné, Panaït Istrati : « Je suis venu dans les lettres françaises avec une âme roumaine, mais je dus lui prêter un masque français. Quand je tentai de rendre à cette âme son visage roumain, je ne le pouvais plus ; elle s'était éloignée avec un visage étranger »… Devenir conscient de soi incite à se voir avec les yeux de l’Autre. C’est ce que font Cornelia Petrescu, frêle mais fort saule pleureur, et Marc Pessin, qui nous parle autrement d’une vision identitaire. Cette rencontre, elle-même improbable, a mis en communication directe et empathique, dans un petit bourg blotti dans les Alpes, une Roumaine adoptée par la France et un Français connaisseur d’art et de poésie roumaine. En résulte un joyau inouï, limpide et tressé de mille fils invisibles qui font oublier le travail qui se cache derrière, le chagrin inguérissable qui nourrit la parole, les non-dits, les doutes et les questions sans réponse, pour éclater au grand jour comme un nuage délicat qui se dissout dans la lumière.»
Simona Modreanu
(Docteur ès Lettres de l'Université Paris 7, écrivain, traducteur, professeur de langue et de littérature française à l'Université "Alexandru Ioan Cuza"de Iaşi)
Poèmes accompagnés de 5 encres de Marc Pessin imprimés en Palatino sur conqueror vergé 21x30 cm en feuilles sous couverture gravée et estampée par MARC PESSIN. Édition tirée à 50 exemplaires numérotés et signés. Achevé en Avril 2016 pour les Éditions ‘’Le Verbe et l’Empreinte’’, atelier d’art à Saint-Laurent-du-Pont Isère.
Un des 50 exemplaires : 80 €
Cornelia Petrescu
Née en 1938 dans une famille d’instituteurs de Bucovine (Nord de la Roumanie), elle a vécu son enfance pendant la période trouble de la guerre, suivie par l’absurdité de la dictature communiste. De formation scientifique, elle a travaillé comme ingénieur en Roumanie et en France où elle s’est exilée en 1986. Son attrait pour l’écriture naquit dans son pays d’adoption, comme un exutoire à la difficulté du déracinement qu’elle vivait.
Ces poésies, qui marquent l’évolution de l’auteur sur la terre d’asile, sont publiées grâce à l’incitation de son éditeur Marc Pessin.
Membre de l’Union des Ecrivains de Roumanie et de la Société des Ecrivains de Bucovine.
Du même auteur:
Cartes postales, roman en langue roumaine, Timpul Iaşi/2014,
La nuit des cigales, roman en langue française, Thot Grenoble/2004, traduit en langue roumaine, Junimea Iaşi /2012,
Le cercle de Siméon, roman en langue roumaine, Junimea Iaşi/2010,
Les écorces d’orange, recueil de nouvelles en langue française, Mon petit éditeur Paris/2010,
Semper Stare, roman en langue française, L’Harmattan Paris/2007,
Un autre regard (coauteur), album bilingue, Tipolidana Suceava/2004,
L’apprentissage de l’humilité, roman en langue roumaine, Junimea Iaşi/2001,
La première vie, roman en langue roumaine, Noël Iaşi/1998,
Rêve de chien. Rêve d’homme, nouvelle de début en langue française, Vernet Isère/1990.
 Liliana Lazar, Enfants du diable, Le Seuil, 2016
Liliana Lazar, Enfants du diable, Le Seuil, 2016 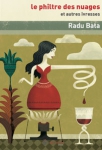
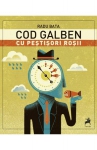 Mais comment préserver la sincérité du cœur dans un monde où « les humains ne savent plus dire qu’amour de soi », dans un monde où les « enfants battus / de la prospérité » doivent fraterniser avec des « loups-garous avares » ou des « vampires malveillants » ? Comment l’individu, condamné à « vivre pluvieux », peut-il affronter les monstres modernes ? Radu Bata n’a pas perdu ses racines roumaines, qu’il revendique çà et là, et n’a rien oublié non plus de la beauté des nuages, de « l’harmonie cosmique », de la « langue du doute », des bienfaits du silence, ni de l’ivresse que procure la vraie poésie, celle de Rimbaud ou de Nichita Stanescu par exemple.
Mais comment préserver la sincérité du cœur dans un monde où « les humains ne savent plus dire qu’amour de soi », dans un monde où les « enfants battus / de la prospérité » doivent fraterniser avec des « loups-garous avares » ou des « vampires malveillants » ? Comment l’individu, condamné à « vivre pluvieux », peut-il affronter les monstres modernes ? Radu Bata n’a pas perdu ses racines roumaines, qu’il revendique çà et là, et n’a rien oublié non plus de la beauté des nuages, de « l’harmonie cosmique », de la « langue du doute », des bienfaits du silence, ni de l’ivresse que procure la vraie poésie, celle de Rimbaud ou de Nichita Stanescu par exemple. Lucian Raicu, Cent lettres de Paris, traduit du roumain par Dominique Ilea, L’Harmattan, 2016
Lucian Raicu, Cent lettres de Paris, traduit du roumain par Dominique Ilea, L’Harmattan, 2016  Irina Adomnicai, Amours de contrebande, L’Harmattan, 2015
Irina Adomnicai, Amours de contrebande, L’Harmattan, 2015 
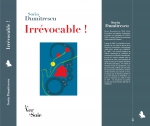 Sorin Dumitrescu, Irrévocable ! éditions Le ver à soie, 2015
Sorin Dumitrescu, Irrévocable ! éditions Le ver à soie, 2015 Gellu Naum, Zenobia, traduit du roumain par Luba Jurgenson et Sebastian Reichmann, éditions Non Lieu, 2015
Gellu Naum, Zenobia, traduit du roumain par Luba Jurgenson et Sebastian Reichmann, éditions Non Lieu, 2015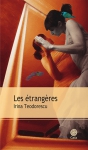 Irina Teodorescu, Les étrangères, Gaïa, 2015
Irina Teodorescu, Les étrangères, Gaïa, 2015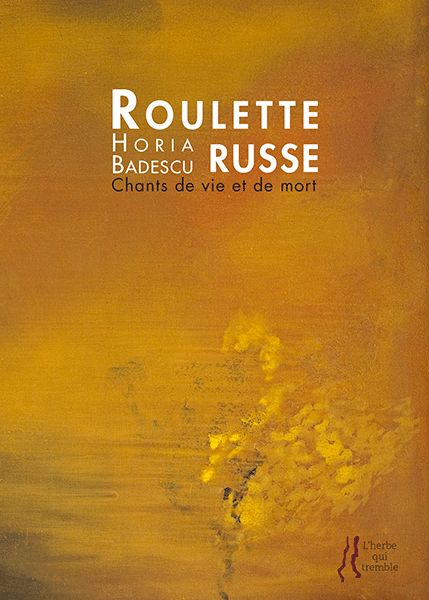
 Benjamin Fondane, Entre philosophie et littérature. Textes réunis par Monique Jutrin, Parole et silence, 2015
Benjamin Fondane, Entre philosophie et littérature. Textes réunis par Monique Jutrin, Parole et silence, 2015 Journal Le Persil
Journal Le Persil Cette centième parution, donc, qui dresse aussi la liste des 99 précédentes, avec tous les détails sur leur sommaire, contient « des textes d’un seul auteur ». Mais le numéro triple qui suit dans la foulée (101-102-103) est, comme la plupart des précédents, laissé à la disposition d’autres auteurs de la Suisse romande (Ivan Farron, Serge Cantero, Bertrand Schmid, Janine Massard, Silvia Härri, Ferenc Rákóczy, Lucas Moreno, Lolvé Tillmans, Dominique Brand, Heike Liedler, Michel Layaz) et de Sanaz Safari, écrivaine iranienne qui, grâce à David André et Marius Daniel Popescu, publie ici ses deux premiers textes écrits en français, « à l’attention d’un lectorat dont elle ignore tout ».
Cette centième parution, donc, qui dresse aussi la liste des 99 précédentes, avec tous les détails sur leur sommaire, contient « des textes d’un seul auteur ». Mais le numéro triple qui suit dans la foulée (101-102-103) est, comme la plupart des précédents, laissé à la disposition d’autres auteurs de la Suisse romande (Ivan Farron, Serge Cantero, Bertrand Schmid, Janine Massard, Silvia Härri, Ferenc Rákóczy, Lucas Moreno, Lolvé Tillmans, Dominique Brand, Heike Liedler, Michel Layaz) et de Sanaz Safari, écrivaine iranienne qui, grâce à David André et Marius Daniel Popescu, publie ici ses deux premiers textes écrits en français, « à l’attention d’un lectorat dont elle ignore tout ». Roumanie, Suisse romande, Iran, et tous les espaces que l’écriture laisse entrevoir : Le Persil, « parole et silence », est un généreux passeur de littérature, au plein sens de l’expression.
Roumanie, Suisse romande, Iran, et tous les espaces que l’écriture laisse entrevoir : Le Persil, « parole et silence », est un généreux passeur de littérature, au plein sens de l’expression.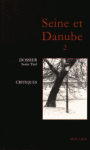
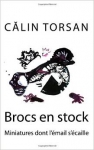 Călin Torsan, Brocs en stock, « Miniatures dont l’émaille s’écaille », traduit du roumain par Gabrielle Danoux, 2015
Călin Torsan, Brocs en stock, « Miniatures dont l’émaille s’écaille », traduit du roumain par Gabrielle Danoux, 2015