 L’intranquille n° 13 (automne-hiver 2017).
L’intranquille n° 13 (automne-hiver 2017).
Ce numéro contient un beau dossier sur les « Poètes de Moldavie », avec des traductions de Doina Ioanid et Jan H. Mysjkin. « Pour fêter une indépendance ».
https://atelierdelagneau.com/5-l-intranquille
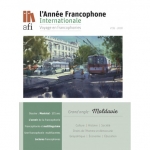 L’Année Francophone Internationale n° 26 (novembre 2017).
L’Année Francophone Internationale n° 26 (novembre 2017).
Au sommaire, entre autres, un Grand Angle consacré à la Moldavie :
Eugeniu Gorean, aquarelliste sans frontières, par Arnaud Galy
Grand Angle, par Nathalie Guillaumin-Pradignac
La langue française en Moldavie : du siècle des Lumières à aujourd’hui, par Olga Turcan
Identité et modernité en République de Moldavie, rétrospective des principales entreprises de construction nationale, par Maria Neagu
La valorisation du potentiel humain et financier de la migration dans le contexte du développement de la République de Moldavie, par Dorin Toma
La Moldavie : défis et atouts géopolitiques, entretien avec Florent Parmentier, propos recueillis par Maria Neagu
Serge Mangole, « Dieu merci », par Arnaud Galy
Ion Stefanita, un mur contre la corruption ambiante, par Arnaud Galy
Alexandru Slavinschi, Médaillé d’or en récitation de poésie, par Arnaud Galy
Petru Vutcãrãu, Un passeur de langue française, de Chisinau à Tokyo, par Arnaud Galy
La Transnistrie, par Arnaud Galy
Solidarité moldafricaine, par Arnaud Galy
Éducation, emploi, migration & francophonie, par Arnaud Galy
Ce résistant qui venait de Moldavie …, par Robin Koskas
Ecaterina Baranov : La musique, contre vents et marées, par Arnaud Galy
http://boutique.agora-francophone.org
http://www.agora-francophone.org/afi/afi-no25-2016-2017/article/moldavie-par-maria-neagu
 Le Haïdouc n° 12-13 (printemps-été 2017).
Le Haïdouc n° 12-13 (printemps-été 2017).
Ce numéro du « Bulletin d’information et de liaison de l’Association des Amis de Panaït Istrati » est, comme les précédents, d’une grande richesse.
Au sommaire : « Panaït Istrati de la divine lettre ornée à la gravure » (éditorial de Christian Delrue) – « La prodigieuse rencontre Vasile Pintea et Panaït Istrati » (Denis Taurel) – « Vasile Pintea. Propos recueillis par André Paléologue » - « Deux lectures des Chardons du Baragan » (Hanny Laufer et Gila Eisenberg-Beigel) – « Du côté des universités et de la recherche » : Aurora Bagiag, Lucie Guesnier, Martha Popovici – « Présence d’Istrati » (les diverses manifestations autour de l’écrivain) et les rubriques traditionnelles : « Brèves et variées », « Activités de l’association », « Regards croisés », « Notices bibliographiques », publications des collaborateurs et amis de l’association…
 « Sous l’égide de Pan »
« Sous l’égide de Pan » Revue Europe n°1061-1062, septembre-octobre 2017. Tristan Tzara, Kurt Schwitters.
Revue Europe n°1061-1062, septembre-octobre 2017. Tristan Tzara, Kurt Schwitters. Mircea Cărtărescu, Tout, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, éditions hochroth Paris, 2017
Mircea Cărtărescu, Tout, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, éditions hochroth Paris, 2017 tentative d’épuisement poétique de la totalité universelle. Et la vie, de la naissance à la mort comprises, de l’espoir au deuil – le deuil émouvant de ce « Victor », double et jumeau apparaissant aussi dans les romans, et qui est « la rose qui manque à tous les bouquets ». Un espoir ? Celui d’une résurrection qui n’efface pas la morbidité :
tentative d’épuisement poétique de la totalité universelle. Et la vie, de la naissance à la mort comprises, de l’espoir au deuil – le deuil émouvant de ce « Victor », double et jumeau apparaissant aussi dans les romans, et qui est « la rose qui manque à tous les bouquets ». Un espoir ? Celui d’une résurrection qui n’efface pas la morbidité : Max Blecher, Corps transparent, traduit du roumain par Gabrielle Danoux, édition bilingue, 2017
Max Blecher, Corps transparent, traduit du roumain par Gabrielle Danoux, édition bilingue, 2017 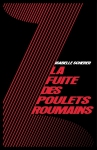 Isabelle Scherer, La fuite des poulets roumains, Librinova, 2017
Isabelle Scherer, La fuite des poulets roumains, Librinova, 2017 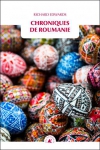 Richard Edwards, Chroniques de Roumanie, Transboréal, 2017
Richard Edwards, Chroniques de Roumanie, Transboréal, 2017  Richard Edwards, Bucarest, 77, boulevard Dacia, photos de Tomo Minoda, dessins de Matei Branea, éditions Non Lieu, 2016
Richard Edwards, Bucarest, 77, boulevard Dacia, photos de Tomo Minoda, dessins de Matei Branea, éditions Non Lieu, 2016 Matéi Visniec, Le Cabaret Dada, traduit du roumain par Mirella Patureau, éditions Non Lieu, 2017
Matéi Visniec, Le Cabaret Dada, traduit du roumain par Mirella Patureau, éditions Non Lieu, 2017  Cahiers Benjamin Fondane
Cahiers Benjamin Fondane
 Mihaela Michailov, Sales gosses, traduit du roumain par Alexandra Lazarescou, Les Solitaires Intempestifs, 2016
Mihaela Michailov, Sales gosses, traduit du roumain par Alexandra Lazarescou, Les Solitaires Intempestifs, 2016  Mircea Cărtărescu, La Nostalgie, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2017
Mircea Cărtărescu, La Nostalgie, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2017  Nicoleta Esinencu, Fuck you, Eu.ro.Pa!, Sans sucre, A(II)Rh+, Mères sans chatte, traduits du roumain par Mirella Patureau, éditions L’espace d’un instant, 2016
Nicoleta Esinencu, Fuck you, Eu.ro.Pa!, Sans sucre, A(II)Rh+, Mères sans chatte, traduits du roumain par Mirella Patureau, éditions L’espace d’un instant, 2016  La crudité du langage, l’abondance lexicale de la révolte se retrouvent dans Sans sucre, dialogue entre « Le frère » et « La sœur » qui échangent sur un rythme de plus en plus rapide, comme en une partie de ping-pong, des considérations sur la vie quotidienne et familiale, l’école, la nourriture, le rationnement (d’où le titre-leitmotiv). L’accélération du mouvement, jusqu’à la déconstruction, figure la transition vers une « liberté », une « intégration européenne » qui ne va pas sans risques ou sans hypocrisie, sans colère et sans violence : « Mettez la merde dans les sacs ! / Enfermez la merde dans les sacs ! / Ensuite jetez-les ! ».
La crudité du langage, l’abondance lexicale de la révolte se retrouvent dans Sans sucre, dialogue entre « Le frère » et « La sœur » qui échangent sur un rythme de plus en plus rapide, comme en une partie de ping-pong, des considérations sur la vie quotidienne et familiale, l’école, la nourriture, le rationnement (d’où le titre-leitmotiv). L’accélération du mouvement, jusqu’à la déconstruction, figure la transition vers une « liberté », une « intégration européenne » qui ne va pas sans risques ou sans hypocrisie, sans colère et sans violence : « Mettez la merde dans les sacs ! / Enfermez la merde dans les sacs ! / Ensuite jetez-les ! ». Simona Sora, Hôtel Universal, traduit du roumain par Laure Hinckel, Belfond, 2016
Simona Sora, Hôtel Universal, traduit du roumain par Laure Hinckel, Belfond, 2016