 Vasile George Dâncu, Maman Univers / Universul Mama, traduit du roumain par Jean Poncet, Jacques André éditeur, 2018
Vasile George Dâncu, Maman Univers / Universul Mama, traduit du roumain par Jean Poncet, Jacques André éditeur, 2018
Présentant le recueil, Jean Poncet écrit : « Dâncu, se refusant à tout artifice littéraire comme à tout pathos, y use de la langue la plus simple, la plus quotidienne. ». C’est ce qui saute aux yeux et à l’esprit lorsqu’on lit ces poèmes dont le personnage central, « Maman », est le pivot affectif omniprésent. L’auteur, chantant l’amour qu’il éprouve pour sa mère morte, fait effectivement appel au langage de la vie courante, en des instantanés, des évocations, des descriptions, des scènes qui surgissent de sa mémoire. Un langage qui puise sa poésie dans l’humilité du style et du personnage :
« plutôt la vie des humbles et des simples
qui vivaient et n’avaient pas de vie
comme
toi
toi tu vivais pour les autres
Maman ».
La simplicité n’empêche pas la force des images portées par les mots (les mots ? « des socs / qui nous labouraient le cœur »), la puissance des paradoxes (« Maman est morte ! […] Christ est ressuscité ! », s’écrie-t-on à Pâques ; ou bien : « les cerisiers sont en fleurs toi tu es en terre »). Les vers, souvent narratifs ou descriptifs, évoquent en un même élan la vie présente et passée, l’amour et la mort, la tendresse et l’ingratitude, l’attachement et le remords, l’égoïsme et la générosité… Bref, la vie d’un fils pour qui sa mère a tout fait et qui, ne l’ayant pas toujours reconnu, lui préférant trop souvent les livres, emplit maintenant son cœur et ses pages de cette
« Maman Univers
souriant aux enfants
du monde entier »,
à qui il n’hésite pas à dire : « ta vie est maintenant ma poésie ».
Même si la mort est maintes fois évoquée avec gravité, le chant du quotidien n’exclut pas l’humour, ni noir ni rose, plutôt d’un gris soutenu. Par exemple lorsque « Maman » se plaignait de son prénom Gafta (elle aurait bien préféré Agata), ou que sont égratignés au passage fonctionnaires, universitaires ou popes de campagne… Mélancolie discrète et sourire complice… Maman Univers est un beau recueil qui aborde un sujet grave et tendre, qui débusque l’exceptionnel dans le quotidien, qui redonne vie au passé, et qui sous son apparente facilité recèle des harmoniques émouvantes et « universelles ».
Jean-Pierre Longre
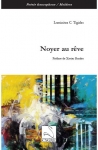 Luminitza C. Tigirlas, Noyer au rêve, préface de Xavier Bordes, Éditions du Cygne, 2018
Luminitza C. Tigirlas, Noyer au rêve, préface de Xavier Bordes, Éditions du Cygne, 2018  Journal Le Persil n° 147, décembre 2017, n° 148-149-150, hiver 2017-2018
Journal Le Persil n° 147, décembre 2017, n° 148-149-150, hiver 2017-2018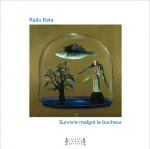 Radu Bata, Survivre malgré le bonheur, Jacques André éditeur, 2018
Radu Bata, Survivre malgré le bonheur, Jacques André éditeur, 2018  Gellu Naum, La Voie du Serpent, préface et traduction du roumain par Sebastian Reichmann, Non Lieu, 2017
Gellu Naum, La Voie du Serpent, préface et traduction du roumain par Sebastian Reichmann, Non Lieu, 2017  Un vrai poète, oui, pour rendre l’atmosphère, les tonalités, les couleurs d’un recueil qui nous fait parcourir la poésie de Gellu Naum de 1968 à 2004, en dix étapes : Athanor (1968), L’Arbre – Animal (1971), Mon père fatigué (1972), Poèmes choisis (1974), La description de la tour (1975), L’autre côté (1980), La rive bleue (1990), La face et la surface (1994), Ascète à la baraque de tir (2000), La voie du serpent (2004), qui donne son titre au volume avec, paradoxalement, seulement deux fragments. Ce parcours manifeste une belle diversité, dont Sebastian Reichmann suggère les grandes lignes dans sa préface, une diversité qui n’exclut pas l’unité garantie par le souffle surréaliste (ou post-surréaliste, comme on voudra) qui anime les vers, les versets, les proses. Souvent affleurent l’écriture automatique et les images surprenantes (« le ciel se remplit de taureaux », « les cheveux défaits parmi les épées et fractions »), le réel se mêle au rêve (ce qui répond parfaitement à la fusion réalisme/onirisme définie par André Breton) : il y a des « statues aux oreilles enterrées dans le sable », le « crépuscule des mots » et le mouvement perpétuel ne sont pas incompatibles avec la recherche d’un financement, et les souvenirs parisiens surgissent de la mémoire consciente ou inconsciente (le Dôme, les anciens amis, des « garçons admirables » qui veulent « briser [une porte] avec leurs viscères »). Rêves (voire « arbres rêveurs »), apparitions (de personnes réelles parfois), visions fantastiques (« un tunnel au centre de la ville / qui ne menait jamais nulle part » ou « les maisons [qui] volaient dans les airs ») hantent les pages du livre, où l’on rencontre aussi la bien-aimée Zenobia, personnage du fameux « rhoman ».
Un vrai poète, oui, pour rendre l’atmosphère, les tonalités, les couleurs d’un recueil qui nous fait parcourir la poésie de Gellu Naum de 1968 à 2004, en dix étapes : Athanor (1968), L’Arbre – Animal (1971), Mon père fatigué (1972), Poèmes choisis (1974), La description de la tour (1975), L’autre côté (1980), La rive bleue (1990), La face et la surface (1994), Ascète à la baraque de tir (2000), La voie du serpent (2004), qui donne son titre au volume avec, paradoxalement, seulement deux fragments. Ce parcours manifeste une belle diversité, dont Sebastian Reichmann suggère les grandes lignes dans sa préface, une diversité qui n’exclut pas l’unité garantie par le souffle surréaliste (ou post-surréaliste, comme on voudra) qui anime les vers, les versets, les proses. Souvent affleurent l’écriture automatique et les images surprenantes (« le ciel se remplit de taureaux », « les cheveux défaits parmi les épées et fractions »), le réel se mêle au rêve (ce qui répond parfaitement à la fusion réalisme/onirisme définie par André Breton) : il y a des « statues aux oreilles enterrées dans le sable », le « crépuscule des mots » et le mouvement perpétuel ne sont pas incompatibles avec la recherche d’un financement, et les souvenirs parisiens surgissent de la mémoire consciente ou inconsciente (le Dôme, les anciens amis, des « garçons admirables » qui veulent « briser [une porte] avec leurs viscères »). Rêves (voire « arbres rêveurs »), apparitions (de personnes réelles parfois), visions fantastiques (« un tunnel au centre de la ville / qui ne menait jamais nulle part » ou « les maisons [qui] volaient dans les airs ») hantent les pages du livre, où l’on rencontre aussi la bien-aimée Zenobia, personnage du fameux « rhoman ». « Sous l’égide de Pan »
« Sous l’égide de Pan » Mircea Cărtărescu, Tout, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, éditions hochroth Paris, 2017
Mircea Cărtărescu, Tout, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, éditions hochroth Paris, 2017 tentative d’épuisement poétique de la totalité universelle. Et la vie, de la naissance à la mort comprises, de l’espoir au deuil – le deuil émouvant de ce « Victor », double et jumeau apparaissant aussi dans les romans, et qui est « la rose qui manque à tous les bouquets ». Un espoir ? Celui d’une résurrection qui n’efface pas la morbidité :
tentative d’épuisement poétique de la totalité universelle. Et la vie, de la naissance à la mort comprises, de l’espoir au deuil – le deuil émouvant de ce « Victor », double et jumeau apparaissant aussi dans les romans, et qui est « la rose qui manque à tous les bouquets ». Un espoir ? Celui d’une résurrection qui n’efface pas la morbidité : Max Blecher, Corps transparent, traduit du roumain par Gabrielle Danoux, édition bilingue, 2017
Max Blecher, Corps transparent, traduit du roumain par Gabrielle Danoux, édition bilingue, 2017  Luminitza C. Tigirlas, Rilke-Poème. Élancé dans l’asphère, L’Harmattan, 2017
Luminitza C. Tigirlas, Rilke-Poème. Élancé dans l’asphère, L’Harmattan, 2017 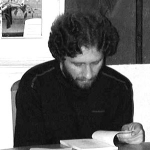 Constantin Acosmei,
Constantin Acosmei,  Marie-Hélène Bratianu, La mémoire des feuilles mortes
Marie-Hélène Bratianu, La mémoire des feuilles mortes Ion Pillat, Le bouclier de Minerve, traduit du roumain par Gabrielle Danoux et Muriel Beauchamp, 2016
Ion Pillat, Le bouclier de Minerve, traduit du roumain par Gabrielle Danoux et Muriel Beauchamp, 2016  Horia Badescu, Le poème va pieds nus, Résidences de l’Arbre à paroles, 2016
Horia Badescu, Le poème va pieds nus, Résidences de l’Arbre à paroles, 2016 Ileana Mălăncioiu, Comme pleurent les âmes seules, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, éditions hochroth Paris, 2016
Ileana Mălăncioiu, Comme pleurent les âmes seules, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, éditions hochroth Paris, 2016 
 Lucian Blaga, Poemele luminii / Les poèmes de la lumière, édition bilingue. Traduit du roumain et avant-propos par Jean Poncet ; postface par Horia Bădescu. Jacques André éditeur / Editura Şcoala Ardeleană, 2016
Lucian Blaga, Poemele luminii / Les poèmes de la lumière, édition bilingue. Traduit du roumain et avant-propos par Jean Poncet ; postface par Horia Bădescu. Jacques André éditeur / Editura Şcoala Ardeleană, 2016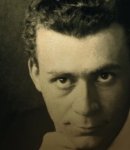 Ainsi bien encadrés, il y a évidemment les textes eux-mêmes, qu’il faut lire, en roumain et/ou en français, en silence et/ou à haute voix. D’emblée, l’auteur nous conduit au cœur de son projet : « Avec ma lumière j’amplifie le mystère du monde. ». Mystère paradoxal fait d’amour, attaché d’une manière constante aux éléments naturels (l’air, la terre, le feu, l’eau – l’herbe, le soleil, les étoiles, le fleuve…). Mystère fait aussi de silence, celui de la mort, celui de l’au-delà où paradis et enfer sont intimement liés :
Ainsi bien encadrés, il y a évidemment les textes eux-mêmes, qu’il faut lire, en roumain et/ou en français, en silence et/ou à haute voix. D’emblée, l’auteur nous conduit au cœur de son projet : « Avec ma lumière j’amplifie le mystère du monde. ». Mystère paradoxal fait d’amour, attaché d’une manière constante aux éléments naturels (l’air, la terre, le feu, l’eau – l’herbe, le soleil, les étoiles, le fleuve…). Mystère fait aussi de silence, celui de la mort, celui de l’au-delà où paradis et enfer sont intimement liés :