 André Paléologue, Cécile Lauru. Le destin d’une compositrice française, de Nantes aux Carpates, Les cahiers de la société historique et archéologique des VIIIe et XVIIe arrondissements, numéro spécial, 2021.
André Paléologue, Cécile Lauru. Le destin d’une compositrice française, de Nantes aux Carpates, Les cahiers de la société historique et archéologique des VIIIe et XVIIe arrondissements, numéro spécial, 2021.
Des nouveautés: voir en fin de page.
Née à Nantes en 1881, Cécile Lauru connut une destinée hors du commun. Très tôt intéressée par la musique grâce à sa mère, qui lui fit d’abord apprendre le violoncelle, admise entre autres aux cours d’harmonie de Charles Tournemire, elle surmonta les obstacles qui, à son époque, barraient aux femmes la carrière de compositrice (voir par exemple les désaccords horrifiés de Gabriel Fauré, et même les sarcasmes de Maurice Ravel…). Ayant fréquenté par hasard les milieux franco-allemands, elle passa dix ans comme enseignante et éducatrice de la Princesse Impériale à la cour de Guillaume II, où elle ne manqua pas de pratiquer la musique, composant notamment des lieds sur des poèmes de la princesse Féodora, publiant et faisant jouer plusieurs de ses compositions. Jeune femme toujours active, elle fonda et dirigea un « foyer » français à Berlin, jusqu’à la guerre de 1914 qui l’obligea à « plier bagage ».
 Mais la rencontre de Vasile Georgescu Paleolog, le coup de foudre réciproque et le mariage changèrent l’orientation de sa vie. Son mari roumain, homme d’affaires, critique d’art, essayiste, était un ami de Constantin Brancuşi, spécialiste de son œuvre, et Cécile put ainsi fréquenter l’avant-garde de l’époque, artistes, hommes de lettres, musiciens, en particulier Erik Satie et le « groupe d’Arcueil ». « En 1921, selon les critères de l’époque, Cécile Lauru Paleolog était une femme comblée : mariée à un homme d’affaires de « bonne condition », mère de trois garçons en pleine forme, douée d’un potentiel créatif reconnu et admiré de son entourage… ». Elle suit son mari dans ses voyages professionnels, puis la famille part s’installer en Roumanie. Dépaysement total pour Cécile, qui va trouver une activité d’ethnomusicologue et continuer à créer, nourrissant ses compositions du « chant de l’Église orthodoxe » et du « folklore musical villageois », et qui durant cette période va composer, « dans un parfait esprit de liberté et de création », ses plus grandes œuvres. Puis c’est à nouveau Berlin pour l’éducation de ses enfants (1930-1940), l’expulsion par le régime nazi, le retour en Roumaine (Bucarest), avec « la musique comme dernier refuge » face aux brimades du régime totalitaire, la possibilité de revenir en France où elle meurt accidentellement en 1959.
Mais la rencontre de Vasile Georgescu Paleolog, le coup de foudre réciproque et le mariage changèrent l’orientation de sa vie. Son mari roumain, homme d’affaires, critique d’art, essayiste, était un ami de Constantin Brancuşi, spécialiste de son œuvre, et Cécile put ainsi fréquenter l’avant-garde de l’époque, artistes, hommes de lettres, musiciens, en particulier Erik Satie et le « groupe d’Arcueil ». « En 1921, selon les critères de l’époque, Cécile Lauru Paleolog était une femme comblée : mariée à un homme d’affaires de « bonne condition », mère de trois garçons en pleine forme, douée d’un potentiel créatif reconnu et admiré de son entourage… ». Elle suit son mari dans ses voyages professionnels, puis la famille part s’installer en Roumanie. Dépaysement total pour Cécile, qui va trouver une activité d’ethnomusicologue et continuer à créer, nourrissant ses compositions du « chant de l’Église orthodoxe » et du « folklore musical villageois », et qui durant cette période va composer, « dans un parfait esprit de liberté et de création », ses plus grandes œuvres. Puis c’est à nouveau Berlin pour l’éducation de ses enfants (1930-1940), l’expulsion par le régime nazi, le retour en Roumaine (Bucarest), avec « la musique comme dernier refuge » face aux brimades du régime totalitaire, la possibilité de revenir en France où elle meurt accidentellement en 1959.
 André Paléologue, historien, petit-fils de Cécile Lauru, était bien placé pour écrire l’histoire de cette musicienne trop méconnue, qui mérite amplement une réhabilitation, elle qui a tenté une « synthèse sonore européenne ». Son ouvrage, fortement documenté, illustré de photos probantes, raconte certes en détail la vie particulièrement remplie de sa grand-mère (qui soit dit en passant avait un caractère bien trempé), en s’appuyant en partie sur les 586 pages manuscrites de ses Souvenirs. Mais il va au-delà : il révèle tout un pan de la musique européenne du XXe siècle, sans se priver de faire quelques apartés, par exemple sur le piano qui a suivi la musicienne dans toutes ses pérégrinations, ni de poser quelques questions ou d’émettre quelques réflexions, par exemple sur la correspondance des arts (musique, littérature, peinture, sculpture…), ou sur le fait de savoir si l’on peut « circonscrire l’espace d’une musique spécifiquement roumaine » (question qui taraudait V. G. Paleolog), ou encore si l’on peut créer, comme le tenta Georges Enesco, une « musique moderne et nationale. » Ainsi, ces pages suscitent l’intérêt à plusieurs titres (biographique, musicologique, historique, critique), et mettent en lumière non seulement l’existence d’une grande figure artistique, mais beaucoup de questions relatives à la vie culturelle européenne.
André Paléologue, historien, petit-fils de Cécile Lauru, était bien placé pour écrire l’histoire de cette musicienne trop méconnue, qui mérite amplement une réhabilitation, elle qui a tenté une « synthèse sonore européenne ». Son ouvrage, fortement documenté, illustré de photos probantes, raconte certes en détail la vie particulièrement remplie de sa grand-mère (qui soit dit en passant avait un caractère bien trempé), en s’appuyant en partie sur les 586 pages manuscrites de ses Souvenirs. Mais il va au-delà : il révèle tout un pan de la musique européenne du XXe siècle, sans se priver de faire quelques apartés, par exemple sur le piano qui a suivi la musicienne dans toutes ses pérégrinations, ni de poser quelques questions ou d’émettre quelques réflexions, par exemple sur la correspondance des arts (musique, littérature, peinture, sculpture…), ou sur le fait de savoir si l’on peut « circonscrire l’espace d’une musique spécifiquement roumaine » (question qui taraudait V. G. Paleolog), ou encore si l’on peut créer, comme le tenta Georges Enesco, une « musique moderne et nationale. » Ainsi, ces pages suscitent l’intérêt à plusieurs titres (biographique, musicologique, historique, critique), et mettent en lumière non seulement l’existence d’une grande figure artistique, mais beaucoup de questions relatives à la vie culturelle européenne.
Jean-Pierre Longre
Pour avoir les dernières nouvelles, un nouveau site:
 F. Brunea-Fox, de son vrai nom Filip Brauner, né en Moldavie en 1898 et mort en 1970, a dans sa jeunesse fréquenté l’avant-garde roumaine, avec notamment son ami B. Fundoianu qui deviendra Benjamin Fondane, puis s’est principalement consacré au journalisme avec des reportages dont l’ouvrage publié par les éditions Non Lieu donne un aperçu représentatif du style original de leur auteur, surnommé « le prince des reporters ». Cinq textes composent cet ouvrage : quatre reportages et un témoignage sous forme de journal en plusieurs parties qui donne son titre au volume, l’ensemble complété par un entretien accordé début 1970 par l’auteur au journaliste Carol Roman.
F. Brunea-Fox, de son vrai nom Filip Brauner, né en Moldavie en 1898 et mort en 1970, a dans sa jeunesse fréquenté l’avant-garde roumaine, avec notamment son ami B. Fundoianu qui deviendra Benjamin Fondane, puis s’est principalement consacré au journalisme avec des reportages dont l’ouvrage publié par les éditions Non Lieu donne un aperçu représentatif du style original de leur auteur, surnommé « le prince des reporters ». Cinq textes composent cet ouvrage : quatre reportages et un témoignage sous forme de journal en plusieurs parties qui donne son titre au volume, l’ensemble complété par un entretien accordé début 1970 par l’auteur au journaliste Carol Roman. Benjamin Fondane, Le mal des fantômes, édition établie par Patrice Beray et Michel Carassou avec la collaboration de Monique Jutrin. Liminaire d’Henri Meschonnic, Non Lieu /
Benjamin Fondane, Le mal des fantômes, édition établie par Patrice Beray et Michel Carassou avec la collaboration de Monique Jutrin. Liminaire d’Henri Meschonnic, Non Lieu / Cahiers Benjamin Fondane
Cahiers Benjamin Fondane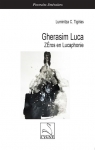 Luminitza G. Tigirlas vient de publier deux ouvrages bien différents l’un de l’autre, mais dont le point commun est la poésie.
Luminitza G. Tigirlas vient de publier deux ouvrages bien différents l’un de l’autre, mais dont le point commun est la poésie.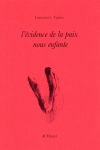 L’évidence de la paix nous enfante
L’évidence de la paix nous enfante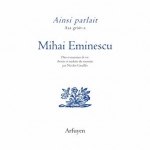 Ainsi parlait / Aşa grăit-a
Ainsi parlait / Aşa grăit-a Les morceaux ici choisis et dûment référencés à la fin du volume sont une excellente approche de l’universalité des préoccupations, du style et du génie d’Eminescu. Vers ou prose, ces brefs fragments abordent, dans le style ramassé de l’aphorisme, tous les thèmes qui fondent la littérature et la philosophie, l’existence et l’essence. « Qu’est-ce à la fin que l’amour ? Du rêve et des apparences, / Des habits étincelants dont revêtir les souffrances. » Évidemment, l’art et la poésie sont mis en avant, car « Un homme médiocre pourra faire un grand politicien, dans certaines circonstances, mais il ne deviendra jamais un grand poète, sous aucune circonstance. » – et le propos satirique alterne ou se marie avec l’expression du désespoir : « Rien ne démoralise plus un peuple que de voir ériger la nullité et le manque de culture au titre de mérites. » Le poète peut-il réunir tous les états d’esprit ? Réponse : « L’homme mélancolique pleure, l’homme joyeux rit, tandis que celui qui est né avec un caractère inaltérable et des prédispositions au scepticisme sifflote. » Et, pas complètement inattendu : « Comme une sorte de refuge face aux nombreux inconvénients de la vie, Dieu dans sa haute bienveillance a donné à l’être humain le rire, avec toute sa gamme, depuis le sourire ironique jusqu’à l’éclat homérique. »
Les morceaux ici choisis et dûment référencés à la fin du volume sont une excellente approche de l’universalité des préoccupations, du style et du génie d’Eminescu. Vers ou prose, ces brefs fragments abordent, dans le style ramassé de l’aphorisme, tous les thèmes qui fondent la littérature et la philosophie, l’existence et l’essence. « Qu’est-ce à la fin que l’amour ? Du rêve et des apparences, / Des habits étincelants dont revêtir les souffrances. » Évidemment, l’art et la poésie sont mis en avant, car « Un homme médiocre pourra faire un grand politicien, dans certaines circonstances, mais il ne deviendra jamais un grand poète, sous aucune circonstance. » – et le propos satirique alterne ou se marie avec l’expression du désespoir : « Rien ne démoralise plus un peuple que de voir ériger la nullité et le manque de culture au titre de mérites. » Le poète peut-il réunir tous les états d’esprit ? Réponse : « L’homme mélancolique pleure, l’homme joyeux rit, tandis que celui qui est né avec un caractère inaltérable et des prédispositions au scepticisme sifflote. » Et, pas complètement inattendu : « Comme une sorte de refuge face aux nombreux inconvénients de la vie, Dieu dans sa haute bienveillance a donné à l’être humain le rire, avec toute sa gamme, depuis le sourire ironique jusqu’à l’éclat homérique. » Paul Paon / Paul Păun, Chimères, Métamorphoses, 2023
Paul Paon / Paul Păun, Chimères, Métamorphoses, 2023 « Dessinateur, poète, écrivain, polémiste (mais aussi médecin et chirurgien) », devenu Paul Paon ou Paul Paon Zaharia après son départ de Roumanie, il fut l’un des membres fondateurs du groupe surréaliste de Bucarest (avec Ghérasim Luca, Gellu Naum, Trost, Virgil Teodorescu), et son œuvre écrite et graphique est marquée à la fois par cette appartenance et par une sensible singularité, d’où peut-être la discrétion avec laquelle elle s’est épanouie. Une exposition rétrospective, donnant une vision globale et néanmoins précise du travail de l’artiste, était donc salutaire – et la librairie Métamorphose s’est chargée de cette présentation, dont a été tiré un très beau catalogue intitulé Chimères, et dont la consultation donne des ouvertures infinies.
« Dessinateur, poète, écrivain, polémiste (mais aussi médecin et chirurgien) », devenu Paul Paon ou Paul Paon Zaharia après son départ de Roumanie, il fut l’un des membres fondateurs du groupe surréaliste de Bucarest (avec Ghérasim Luca, Gellu Naum, Trost, Virgil Teodorescu), et son œuvre écrite et graphique est marquée à la fois par cette appartenance et par une sensible singularité, d’où peut-être la discrétion avec laquelle elle s’est épanouie. Une exposition rétrospective, donnant une vision globale et néanmoins précise du travail de l’artiste, était donc salutaire – et la librairie Métamorphose s’est chargée de cette présentation, dont a été tiré un très beau catalogue intitulé Chimères, et dont la consultation donne des ouvertures infinies. Après une préface de Denis Moscovici et un parcours biographique de Monique Yaari mêlé de souvenirs (il était son oncle), et avant un bien utile tableau chronologique, quatre grandes sections composent l’ouvrage : la première et la plus importante (en longueur et en beauté), une vue significative et chronologique des dessins commentée par Radu Stern, spécialiste des avant-gardes ; puis une transcription du Carnet écrit par l’artiste entre 1984 et 1991, suivie de reproductions de livres, tracts, lettres et manuscrits donnant une idée fidèle de ses publications individuelles et collectives ; en troisième lieu, le rappel, documents à l’appui, d’expositions et de catalogues antérieurs (de Bucarest à Londres en passant par Tel-Aviv, Jaffa, Paris, Marseille etc.) ; enfin, des dessins, photographies et documents évoquant des souvenirs amoureux (avec des portraits de « Réni », sa femme) et amicaux (Ghérasim Luca et plusieurs autres).
Après une préface de Denis Moscovici et un parcours biographique de Monique Yaari mêlé de souvenirs (il était son oncle), et avant un bien utile tableau chronologique, quatre grandes sections composent l’ouvrage : la première et la plus importante (en longueur et en beauté), une vue significative et chronologique des dessins commentée par Radu Stern, spécialiste des avant-gardes ; puis une transcription du Carnet écrit par l’artiste entre 1984 et 1991, suivie de reproductions de livres, tracts, lettres et manuscrits donnant une idée fidèle de ses publications individuelles et collectives ; en troisième lieu, le rappel, documents à l’appui, d’expositions et de catalogues antérieurs (de Bucarest à Londres en passant par Tel-Aviv, Jaffa, Paris, Marseille etc.) ; enfin, des dessins, photographies et documents évoquant des souvenirs amoureux (avec des portraits de « Réni », sa femme) et amicaux (Ghérasim Luca et plusieurs autres).  Marina Anca,
Marina Anca,  Luminitza C. Tigirlas, Eau prisonnière, Jacques André éditeur, 2022
Luminitza C. Tigirlas, Eau prisonnière, Jacques André éditeur, 2022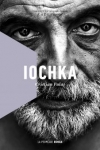
 Catherine Durandin, Ma Roumanie communiste, L’Harmattan, 2023
Catherine Durandin, Ma Roumanie communiste, L’Harmattan, 2023 « Universitaire et essayiste Georges Banu est mort à l’âge de 79 ans, fait savoir l’un de ses éditeurs Actes-Sud. Arrivé en France en 1971, Georges Banu était né le 22 juin 1943 à Buzău en Roumanie. Codirecteur de la revue Alternatives théâtrales, il dirigeait la collection « Le temps du théâtre » chez Actes-Sud.
« Universitaire et essayiste Georges Banu est mort à l’âge de 79 ans, fait savoir l’un de ses éditeurs Actes-Sud. Arrivé en France en 1971, Georges Banu était né le 22 juin 1943 à Buzău en Roumanie. Codirecteur de la revue Alternatives théâtrales, il dirigeait la collection « Le temps du théâtre » chez Actes-Sud. Vladimir Cretulescu, Ethnicité aroumaine, nationalité roumaine.
Vladimir Cretulescu, Ethnicité aroumaine, nationalité roumaine. 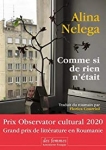 Alina Nelega, Comme si de rien n’était, traduit du roumain par Florica Courriol, éditions des femmes, 2021
Alina Nelega, Comme si de rien n’était, traduit du roumain par Florica Courriol, éditions des femmes, 2021 Pompei Cocean, La Roumanie au début du troisième millénaire. Préface de Jean-Marie Miossec, L’Harmattan, 2021
Pompei Cocean, La Roumanie au début du troisième millénaire. Préface de Jean-Marie Miossec, L’Harmattan, 2021 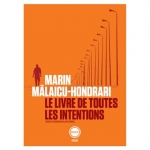 Marin Malaicu-Hondrari, Le livre de toutes les intentions, traduit du roumain par Laure Hinckel, Inculte, 2021
Marin Malaicu-Hondrari, Le livre de toutes les intentions, traduit du roumain par Laure Hinckel, Inculte, 2021 Catherine Durandin
Catherine Durandin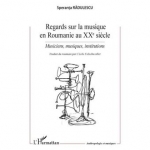 Speranţa Rădulescu, Regards sur la musique roumaine au XXe siècle. Musiciens, musiques, institutions, traduit du roumain par Cécile Folschweiller, L’Harmattan, 2021
Speranţa Rădulescu, Regards sur la musique roumaine au XXe siècle. Musiciens, musiques, institutions, traduit du roumain par Cécile Folschweiller, L’Harmattan, 2021 Norman Manea, Le retour du hooligan,
Norman Manea, Le retour du hooligan,  Nicoleta Esinencu, L'Évangile selon Marie – Trilogie, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, L’Arche, 2021
Nicoleta Esinencu, L'Évangile selon Marie – Trilogie, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, L’Arche, 2021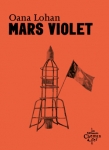 Oana Lohan, Mars violet, Les éditions du chemin de fer, 2021
Oana Lohan, Mars violet, Les éditions du chemin de fer, 2021 Florina Ilis, Le livre des nombres, traduit du roumain par Marily Le Nir, Éditions des Syrtes, 2021
Florina Ilis, Le livre des nombres, traduit du roumain par Marily Le Nir, Éditions des Syrtes, 2021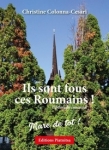 Christine Colonna-Cesari, Ils sont fous ces Roumains !, L’eldorado roumain, éditions Piatnitsa, 2021
Christine Colonna-Cesari, Ils sont fous ces Roumains !, L’eldorado roumain, éditions Piatnitsa, 2021  L’entrée de la Roumanie dans la grande guerre.
L’entrée de la Roumanie dans la grande guerre. Sylvain Audet-Gainar, Micmac à Bucarest, éditions Ex Aequo, 2020
Sylvain Audet-Gainar, Micmac à Bucarest, éditions Ex Aequo, 2020 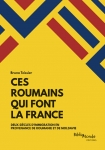 Bruno Teissier, Ces Roumains qui font la France. Deux siècles d’immigration en provenance de Roumanie et de Moldavie, BiblioMonde Éditions, 2020
Bruno Teissier, Ces Roumains qui font la France. Deux siècles d’immigration en provenance de Roumanie et de Moldavie, BiblioMonde Éditions, 2020  Jean-Pierre Longre, Richesses de l'incertitude. Queneau et Cioran /
Jean-Pierre Longre, Richesses de l'incertitude. Queneau et Cioran /