 Richard Edwards, Bucarest, 77, boulevard Dacia, photos de Tomo Minoda, dessins de Matei Branea, éditions Non Lieu, 2016
Richard Edwards, Bucarest, 77, boulevard Dacia, photos de Tomo Minoda, dessins de Matei Branea, éditions Non Lieu, 2016
En 1921, Henri Focillon et son homologue George Oprescu – tous deux grands théoriciens de l’art, éminents critiques, passionnés d’art populaire roumain, figures de référence dans les milieux culturels français et roumains – se rencontrent au musée des Beaux-Arts de Lyon à l’occasion d’un colloque sur l’« histoire de l’art populaire ». C’est à cet endroit et à ce moment que naît entre eux, outre une profonde amitié, l’idée de créer à Bucarest un lieu où se mêleront les cultures de leurs deux pays. Ainsi se forge le projet qui se concrétisera sous la forme de l’Institut français des hautes études en Roumanie, l’ancêtre de l’actuel Institut Français de Bucarest (qui s’installera dans ses murs définitifs, boulevard Dacia, en 1936).
C’est l’histoire de ce haut lieu de la culture que retrace Richard Edwards dans un livre à la fois précisément documenté et très vivant. Illustrée de photos, de dessins et de plans, ponctuée par les portraits des personnages qui l’ont marquée, à quelque niveau de la hiérarchie que ce soit, parsemée d’anecdotes touchantes ou savoureuses, personnelles ou collectives, et d’énigmes captivantes (voyez le chapitre III, dont le titre mystérieux – « et si la septième marche du grand escalier n’avait pas existé » – donne lieu à une enquête poussée), de descriptions détaillées (bâtiments, mobilier, bibliothèque, salle de cinéma…), cette histoire se lit comme un roman, le roman d’une institution qui a connu toutes les vicissitudes du XXème siècle et qui a été partie prenante de la vie culturelle, politique, sociale, internationale de la Roumanie (et de ses relations avec la France). « Bousculé par l’histoire, le 77 du boulevard Dacia semble avoir tout vécu, le pire, le meilleur, le douloureux, l’inattendu, le grave, le frivole, l’éphémère comme le durable. Et ce qu’il est aujourd’hui n’est pas la somme de son “avant”, il est autre, et pourtant, il a été, il reste une espérance, une âme sensible, pétrie d’une nostalgie des temps passés. ».
L’auteur l’écrit d’emblée : « Le bâtiment du 77 boulevard Dacia […] recèle une âme forte, de multiples vies, des péripéties parfois fort mouvementées, à l’image des événements qui alimentent l’histoire de la France et celle de la Roumanie. L’immeuble du 77, inséré dans l’espace urbain bucarestois, nous emmène dans l’histoire. C’est cela que je raconte. ». L’essentiel y est : l’Institut, véritable « fourmilière », est bien vivant, Richard Edwards nous en donne la preuve dans un récit plein de rebondissements, et en profite pour rappeler certains moments essentiels de la riche histoire des relations culturelles entre la Roumanie et la France. Il s’agit bien, comme l’annonce le sous-titre, d’« une histoire franco-roumaine ».
Jean-Pierre Longre
 Luminitza C. Tigirlas, Rilke-Poème. Élancé dans l’asphère, L’Harmattan, 2017
Luminitza C. Tigirlas, Rilke-Poème. Élancé dans l’asphère, L’Harmattan, 2017 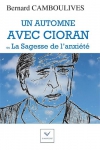 Bernard Camboulives, Un automne avec Cioran ou La sagesse de l’anxiété, Éditions Nicole Vaillant, 2016
Bernard Camboulives, Un automne avec Cioran ou La sagesse de l’anxiété, Éditions Nicole Vaillant, 2016  Lucian Raicu, Cent lettres de Paris, traduit du roumain par Dominique Ilea, L’Harmattan, 2016
Lucian Raicu, Cent lettres de Paris, traduit du roumain par Dominique Ilea, L’Harmattan, 2016