
Ilarie Voronca, Souvenirs de la planète Terre, préface de Nicolas Cavaillès, Arfuyen, 2025
Né Eduard Marcus à Brăila, Ilarie Voronca (1903-1946) fait partie de ces artistes d’avant-garde qui, venus de Roumanie, ont enrichi la culture française de leur inventivité intellectuelle et esthétique, de leurs idées et de leurs œuvres ; on connaît sans doute mieux Tzara ou Fondane, mais Voronca a nourri la littérature d’une particulière modernité, et Souvenirs de la planète Terre, sorte de « testament littéraire » de l’inventeur de l’ « intégralisme », en témoigne singulièrement. Avec cet ouvrage, l’écrivain « offre une expérience littéraire unique, un dépassement des plus sombres constats dans une fausse naïveté conceptuelle et hallucinée qui à chaque page apporte de nouvelles formules merveilleuses », écrit Nicolas Cavaillès.
Le protagoniste du roman, Yves (un prénom manifestement issu des initiales de l’auteur), se voit comme « un voyageur venu d’une planète ou de quelque univers inconnu » et découvre notre monde en une vision qui rebat fondamentalement les cartes : les végétaux plus puissants que les hommes, ou ceux-ci aux ordres des animaux, qui, comme les ânes, sont capables de discuter poésie entre eux ; ou encore les machines (par exemple les moissonneuses-batteuses) à l’origine de la création de l’homme (y compris de son âme)… Yves, peu à peu, fait des découvertes étonnantes et angoissantes sur le monde et la société, sur l’injustice qui fixe les « hommes-vis » à des places dont ils ne peuvent s’extirper, sur l’absurdité de l’existence, sur la vanité humaine (« Tout cela est à démolir », semble-t-il en conclure) ; mais tout n’est pas perdu : « La machine bonne et affable se tiendra aux côtés de l’homme. Elle fera un avec l’homme. Et Yves eut la vision d’un nouveau centaure, d’une nouvelle mythologie. L’homme accouplé à la machine. » Vision en tout cas moins pessimiste qu’une prophétie précédente, pourtant vérifiée : « Ce sont les nouvelles machines qui poussent jusqu’à la dernière limite l’esclavage de l’homme et n’hésitent devant aucun obstacle pour satisfaire leurs caprices. »
Ce qui précède n’est qu’un des angles de lecture possibles. Écrivain de l’absurde, Ilarie Voronca se situe dans lignée de Lautréamont, Urmuz, Raymond Roussel et quelques autres inventeurs de l’absolu. Poète, aussi, et ce roman en porte la marque. Quelques exemples ? À propos des plantes : « Ô pacifiques reines, régnant sur la vie et sur la mort et dont les seules armes sont vos parfums et vos couleurs ! » ; à propos des batteuses : « Ce sont de grands oiseaux migrateurs qui font leur nid pendant les mois de soleil parmi les céréales » ; à propos de la nuit urbaine : « Oh, calme majesté des avenues sous la lune ! Jardins baignés d’une musique qui se déverse d’entre les cordes des arbres dont chacun porte une étoile comme une sourdine. » Et ce bel alexandrin concluant l’un des poèmes insérés dans la prose : « Mes os seront pareils aux herbes arrachées. » Absurde et poésie font aussi bon ménage avec un humour cachant plus ou moins bien l’angoisse, comme dans cette maxime : « Les hommes ne sont des hommes que parce qu’ils croient être des hommes. », ou dans la découverte d’une cruelle anthropophagie : « Yves s’aperçut que les maisons mangeaient. […] Plus elles étaient vieilles, plus elles tombaient en ruines, plus il leur fallait d’hommes, de femmes et d’enfants à mastiquer. »
Souvenirs de la planète Terre est une livre « intégral » où, par le truchement de la limpidité de la prose et du vertige de la poésie, se mêlent l’espoir et le désespoir, l’humour et la soif d’absolu, le mysticisme et la satire, la générosité et la dérision. La formule de Nicolas Cavaillès est parlante : Ilarie Voronca est un « Voyant inquiet », et c’est sans doute l’inquiétude qui l’a emporté.
Jean-Pierre Longre
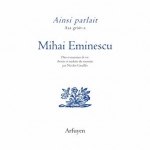 Ainsi parlait / Aşa grăit-a
Ainsi parlait / Aşa grăit-a Les morceaux ici choisis et dûment référencés à la fin du volume sont une excellente approche de l’universalité des préoccupations, du style et du génie d’Eminescu. Vers ou prose, ces brefs fragments abordent, dans le style ramassé de l’aphorisme, tous les thèmes qui fondent la littérature et la philosophie, l’existence et l’essence. « Qu’est-ce à la fin que l’amour ? Du rêve et des apparences, / Des habits étincelants dont revêtir les souffrances. » Évidemment, l’art et la poésie sont mis en avant, car « Un homme médiocre pourra faire un grand politicien, dans certaines circonstances, mais il ne deviendra jamais un grand poète, sous aucune circonstance. » – et le propos satirique alterne ou se marie avec l’expression du désespoir : « Rien ne démoralise plus un peuple que de voir ériger la nullité et le manque de culture au titre de mérites. » Le poète peut-il réunir tous les états d’esprit ? Réponse : « L’homme mélancolique pleure, l’homme joyeux rit, tandis que celui qui est né avec un caractère inaltérable et des prédispositions au scepticisme sifflote. » Et, pas complètement inattendu : « Comme une sorte de refuge face aux nombreux inconvénients de la vie, Dieu dans sa haute bienveillance a donné à l’être humain le rire, avec toute sa gamme, depuis le sourire ironique jusqu’à l’éclat homérique. »
Les morceaux ici choisis et dûment référencés à la fin du volume sont une excellente approche de l’universalité des préoccupations, du style et du génie d’Eminescu. Vers ou prose, ces brefs fragments abordent, dans le style ramassé de l’aphorisme, tous les thèmes qui fondent la littérature et la philosophie, l’existence et l’essence. « Qu’est-ce à la fin que l’amour ? Du rêve et des apparences, / Des habits étincelants dont revêtir les souffrances. » Évidemment, l’art et la poésie sont mis en avant, car « Un homme médiocre pourra faire un grand politicien, dans certaines circonstances, mais il ne deviendra jamais un grand poète, sous aucune circonstance. » – et le propos satirique alterne ou se marie avec l’expression du désespoir : « Rien ne démoralise plus un peuple que de voir ériger la nullité et le manque de culture au titre de mérites. » Le poète peut-il réunir tous les états d’esprit ? Réponse : « L’homme mélancolique pleure, l’homme joyeux rit, tandis que celui qui est né avec un caractère inaltérable et des prédispositions au scepticisme sifflote. » Et, pas complètement inattendu : « Comme une sorte de refuge face aux nombreux inconvénients de la vie, Dieu dans sa haute bienveillance a donné à l’être humain le rire, avec toute sa gamme, depuis le sourire ironique jusqu’à l’éclat homérique. »