 Radu Bata, Le Blues roumain, vol. 3, anthologie implausible de poésies. Préambule de Muriel Augry, préface de Cali, mot de la fin de Charles Gonzalès, Éditions Unicité, 2022
Radu Bata, Le Blues roumain, vol. 3, anthologie implausible de poésies. Préambule de Muriel Augry, préface de Cali, mot de la fin de Charles Gonzalès, Éditions Unicité, 2022
Il y a eu l’anthologie « imprévue », puis l’anthologie « désirée », et maintenant voici l’anthologie « implausible ». Implausible, certes, mais il est bien là, ce troisième volume bourré de poésies de toutes sortes, d’auteurs d’une diversité à peine croyable. Il fallait un lecteur insatiable et averti, un traducteur infatigable et affectueux (il nous le redit : ses traductions sont « hypocoristiques »), un esprit aussi ouvert que celui de Radu Bata pour nous livrer un florilège qui n’a pas d’équivalent dans la langue française.
Car Le Blues roumain, dans sa surprenante abondance, ses séduisantes sinuosités, son infinie liberté, n'a rien de traditionnel, rien d’académique. À côté des valeurs sûres comme Ana Blandiana, Mircea Cărtărescu, Mircea Dinescu, Paul Vinicius, Nichita Stănescu, Andrei Crăciun et Radu Bata en personne, il y a toutes celles et tous ceux que l’on découvre avec les délices de la nouveauté et l’émotion d’une affection partagée. Oui, il les aime, ses poètes, Radu Bata, et cet amour s’insinue, se répand chez les lecteurs – à des degrés divers, bien sûr, mais sans faux-semblants.
Ne touchons pas aux textes, ne les déflorons pas à coups de citations arbitraires ou d’analyses érudites (qui toutefois prouveraient, s’il en était besoin, que nous avons affaire à de la poésie au plein sens du terme). Laissons-les nous parler de la vie quotidienne, de la souffrance des âmes et des corps, du temps et de la mémoire ; laissons-les nous chanter les rêves fous et la douce douleur du « dor », l’amour et la tendresse, le bonheur au conditionnel ; laissons-les nous montrer les images paisibles de la nature et les visions fantastiques de l’esprit ; laissons-les nous évoquer la Roumanie avec son passé, sa tsuica, les tramways de Bucarest et son « Paysan du Danube » ; laissons-les nous présenter Eminescu, Mozart, Jung, Breton ou Vlad l’Empaleur ; laissons-les fustiger avec nous les abus de notre époque et espérer un avenir de simplicité, de sincérité, de gentillesse… Voilà, s’il fallait lui trouver une utilité, à quoi sert la poésie. Entre langue roumaine et langue française, « les vers murmurent à travers l’Europe », comme nous le fait entendre Ana Pop Sirbu ; et on en redemande ! Disons-le avec Andrei Crăciun : « Il est naturel que la poésie n’ait pas de fin ».
Jean-Pierre Longre
Les auteurs : Luminita Amarie, Alexandru Andrieş, Andreea Apostu, Şerban Axinte, Ana Barton, Radu Bata, Anca-Iulia Beidac, Ana Blandiana, Geo Bogza, Dorina Brânduşa Landén, Emil Brumaru, Ion Calotă, Virgil Carianopol, Ana Căbulea, Mircea Cărtărescu, Denisa Comănescu, Ben Corlaciu, George Coşbuc, Andrei Crăciun, Corina Daşoveanu, Mircea Dinescu, Adrian Diniş, Gabriel Dinu, Adela Efrim, Vasile Petre Fati, Raluca Feher, Irina-Roxana Georgescu, Mugur Grosu, Cristina Hermeziu, Claudiu Komartin, Alexandra-Mălina Lipară, Aurelian Mareș, Mariana Marin, Ioan Mateiciuc, Andra Mateucă, Ştefan Manasia, Ciprian Măceșaru, Marin Mălaicu Hondrari, Rozana Mihalache, Ştefania Mihalache, Andrei Mocuța, Ion Mureşan, Emilia Nedelcoff, Dana Nicolaescu, Felix Nicolau, Andrei Novac, Dana Novac, Cosmin Perţa, Violeta Pintea, Rică Poindronescu, Ioan Es Pop, Savu Popa, Radmila Popovici, Sorina Rîndaşu, Mihai Radu, Petronela Rotar, Carmen Secere, Roxana Sicoe-Tirea, Ana Pop Sirbu, Octavian Soviany, Cătălina Stănescu, Nichita Stănescu, Ioana Maria Stăncescu, Elena Stîngă, Petre Stoica, Robert Şerban, Iulian Tănase, Ioana Tătărușanu, Elsa Dorval Tofan, Tatiana Țîbuleac, Mircea Țuglea, George Vasilievici, Silviu Vergu, Gabriela Vieru, Paul Vinicius, Demetra Vlas, Vitalie Vovc.
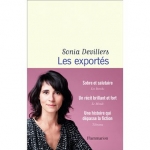 Sonia Devillers, Les exportés, Flammarion, 2022
Sonia Devillers, Les exportés, Flammarion, 2022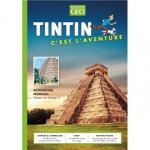 Tintin c’est l’aventure
Tintin c’est l’aventure Mais ce nouveau numéro de Tintin c’est l’aventure aborde bien d’autres thématiques concernant le patrimoine et des trésors en danger aussi divers que ceux qui figurent dans les albums d’Hergé. Monuments lointains ou proches, animaux exotiques, ruines diverses, musées, et aussi le château de Moulinsart (fortement inspiré de celui de Cheverny) amènent à poser des questions cruciales sur la notion de patrimoine (« construction sociale » selon la spécialiste Julie Deschepper), sur le tourisme de masse (genre « Joyeux Turlurons »), sur le drame que fut la déportation des Amérindiens – on en passe. C’est aussi l’occasion de lire une BD inédite d’Aude Mermillon et Louise Dupraz, et de découvrir, illustrations à l’appui, l’ « univers inimitable » du dessinateur-voyageur suisse Cosey.
Mais ce nouveau numéro de Tintin c’est l’aventure aborde bien d’autres thématiques concernant le patrimoine et des trésors en danger aussi divers que ceux qui figurent dans les albums d’Hergé. Monuments lointains ou proches, animaux exotiques, ruines diverses, musées, et aussi le château de Moulinsart (fortement inspiré de celui de Cheverny) amènent à poser des questions cruciales sur la notion de patrimoine (« construction sociale » selon la spécialiste Julie Deschepper), sur le tourisme de masse (genre « Joyeux Turlurons »), sur le drame que fut la déportation des Amérindiens – on en passe. C’est aussi l’occasion de lire une BD inédite d’Aude Mermillon et Louise Dupraz, et de découvrir, illustrations à l’appui, l’ « univers inimitable » du dessinateur-voyageur suisse Cosey. Ce volume, où alternent textes, interviews, images, poursuit l’exploration de l’univers de Tintin, une exploration variée, approfondie, toujours passionnante, jamais épuisée. Et un univers qui est d’abord, mentalement et artistiquement, celui d’Hergé, qui confia à Numa Sadoul : « Si je me suis mis à voyager ce n’est pas seulement pour voir de nouveaux paysages, mais pour découvrir d’autres modes de vie, d’autres façons de penser ; en somme pour élargir ma vision du monde. »
Ce volume, où alternent textes, interviews, images, poursuit l’exploration de l’univers de Tintin, une exploration variée, approfondie, toujours passionnante, jamais épuisée. Et un univers qui est d’abord, mentalement et artistiquement, celui d’Hergé, qui confia à Numa Sadoul : « Si je me suis mis à voyager ce n’est pas seulement pour voir de nouveaux paysages, mais pour découvrir d’autres modes de vie, d’autres façons de penser ; en somme pour élargir ma vision du monde. » Cahiers Benjamin Fondane n° 25, « Dialogues », 2022
Cahiers Benjamin Fondane n° 25, « Dialogues », 2022 Ciprian Apetrei, L’Homme à sa fenêtre, traduit du roumain par Alina Marin et Angela Nache Mamier, Mon édition, 2021
Ciprian Apetrei, L’Homme à sa fenêtre, traduit du roumain par Alina Marin et Angela Nache Mamier, Mon édition, 2021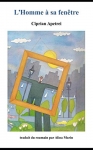 Il y a là des souvenirs personnels, des évocations du pays d’origine – Bucarest, Făgăraş, « l’élève Popescu » ou Gheorghe « le Repenti ». Il y a des anecdotes savoureuses telles que celle du fonctionnaire qui roucoule au téléphone au lieu de s’occuper du public ; ou du jeune homme timide qui devient un insatiable don juan ; ou d’une baguette de pain qui réapparaît comme par magie ; ou encore d’une pittoresque dispute dans le RER B, où circulent apparemment « marraine la bonne fée et sa sœur. » Car le merveilleux et même le fantastique côtoient le quotidien ; on est transporté dans l’Olympe pour assister aux amours d’un dieu et d’une fée, on apprend l’histoire de « la Reine aux longs doigts », on pénètre avec un druide, un cerf, un lion ailé et « une princesse cavalière » dans « la forêt des mauvaises pensées. »
Il y a là des souvenirs personnels, des évocations du pays d’origine – Bucarest, Făgăraş, « l’élève Popescu » ou Gheorghe « le Repenti ». Il y a des anecdotes savoureuses telles que celle du fonctionnaire qui roucoule au téléphone au lieu de s’occuper du public ; ou du jeune homme timide qui devient un insatiable don juan ; ou d’une baguette de pain qui réapparaît comme par magie ; ou encore d’une pittoresque dispute dans le RER B, où circulent apparemment « marraine la bonne fée et sa sœur. » Car le merveilleux et même le fantastique côtoient le quotidien ; on est transporté dans l’Olympe pour assister aux amours d’un dieu et d’une fée, on apprend l’histoire de « la Reine aux longs doigts », on pénètre avec un druide, un cerf, un lion ailé et « une princesse cavalière » dans « la forêt des mauvaises pensées. »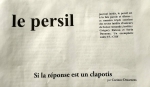 Sous la houlette de l’infatigable Marius Daniel Popescu, deux numéros triples du
Sous la houlette de l’infatigable Marius Daniel Popescu, deux numéros triples du  Le numéro précédent (mars 2022) « contient des textes inédits d’auteurs de Suisse romande », en prose ou en vers : Corinne Desarzens, François Hüssy, Philippe Veuve, Emilie Bilman, Jean-Luc Dépraz, Fiorenzino Iori, Esther Sarre, Vincent Yersin, Véronique Emmenegger, Adrian Rachieru, Matthieu Ruf, Valérie Gillard. Les dernières pages accueillent la poésie de deux invités : Grégory Rateau, qui est entre autres rédacteur en chef du Petit Journal de Bucarest, et Sorin Dananae (texte traduit du roumain par Marius Daniel Popescu). Depuis la Suisse, Marius Daniel Popescu reste toujours fidèle à sa Roumanie natale…
Le numéro précédent (mars 2022) « contient des textes inédits d’auteurs de Suisse romande », en prose ou en vers : Corinne Desarzens, François Hüssy, Philippe Veuve, Emilie Bilman, Jean-Luc Dépraz, Fiorenzino Iori, Esther Sarre, Vincent Yersin, Véronique Emmenegger, Adrian Rachieru, Matthieu Ruf, Valérie Gillard. Les dernières pages accueillent la poésie de deux invités : Grégory Rateau, qui est entre autres rédacteur en chef du Petit Journal de Bucarest, et Sorin Dananae (texte traduit du roumain par Marius Daniel Popescu). Depuis la Suisse, Marius Daniel Popescu reste toujours fidèle à sa Roumanie natale… Robert Adam, Deux siècles de populisme roumain, traduit du roumain par Cătălina Voican, Non Lieu, 2021
Robert Adam, Deux siècles de populisme roumain, traduit du roumain par Cătălina Voican, Non Lieu, 2021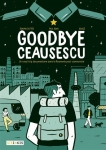 Romain Dutter (scénario), Bouqué (dessin), Paul Bona (couleurs), Goodbye Ceauşescu, « Un road-trip documentaire dans la Roumanie post-communiste », Steinkis, 2021
Romain Dutter (scénario), Bouqué (dessin), Paul Bona (couleurs), Goodbye Ceauşescu, « Un road-trip documentaire dans la Roumanie post-communiste », Steinkis, 2021 Six chapitres rythment cette visite. Après le premier (« Goodbye Ceauşescu ») qui résume l’histoire de la Roumanie (certaines de ses légendes aussi), les cinq suivants sont consacrés à de grandes étapes géographiques : les bords de la Mer Noire, de Constanţa au Delta du Danube, Bucarest, son éclectisme et sa vie animée, Timişoara, ville multiculturelle d’où est partie la « Révolution » de 1989, la Transylvanie, sa diversité ethnique et sa richesse historique, la Moldavie, sa campagne sereine et ses magnifiques monastères. Rien n’échappe à l’observation bienveillante des voyageurs qui, s’adressant au lecteur, espèrent que « cette lecture vous a plu et qu’elle vous a permis de renouveler la perception que vous aviez de la Roumanie et de sa population, de déconstruire certains clichés. »
Six chapitres rythment cette visite. Après le premier (« Goodbye Ceauşescu ») qui résume l’histoire de la Roumanie (certaines de ses légendes aussi), les cinq suivants sont consacrés à de grandes étapes géographiques : les bords de la Mer Noire, de Constanţa au Delta du Danube, Bucarest, son éclectisme et sa vie animée, Timişoara, ville multiculturelle d’où est partie la « Révolution » de 1989, la Transylvanie, sa diversité ethnique et sa richesse historique, la Moldavie, sa campagne sereine et ses magnifiques monastères. Rien n’échappe à l’observation bienveillante des voyageurs qui, s’adressant au lecteur, espèrent que « cette lecture vous a plu et qu’elle vous a permis de renouveler la perception que vous aviez de la Roumanie et de sa population, de déconstruire certains clichés. » Le but est atteint, puisque l’essentiel est dit et montré, paysages et monuments, mentalités et coutumes, charmes et imperfections, contrastes entre villes et campagnes, entre traditions et modernité, relations entre les communautés (Roumains, Hongrois, Tziganes…). Quelques documents photographiques et quelques considérations révélatrices de la manière dont les Roumains voient la France et les Français ponctuent cet ouvrage qui, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce séduisant pays, est une prometteuse invitation au voyage, et pour les autres une belle invitation à y retourner.
Le but est atteint, puisque l’essentiel est dit et montré, paysages et monuments, mentalités et coutumes, charmes et imperfections, contrastes entre villes et campagnes, entre traditions et modernité, relations entre les communautés (Roumains, Hongrois, Tziganes…). Quelques documents photographiques et quelques considérations révélatrices de la manière dont les Roumains voient la France et les Français ponctuent cet ouvrage qui, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce séduisant pays, est une prometteuse invitation au voyage, et pour les autres une belle invitation à y retourner.  Le Haïdouc
Le Haïdouc Cahiers Benjamin Fondane
Cahiers Benjamin Fondane
 « Promotion d’un pion » évoque le travail d’été d’un étudiant en sylviculture qui, pour gagner de l’argent, s’est fait engager pour trois mois au « Bureau de Tourisme pour la Jeunesse », accueillant des vacanciers venus visiter la belle ville de l’Église Noire entourée de montagnes et cherchant, pour une somme modique, à loger dans un foyer d’étudiants. Nous sommes au temps du « parti unique », des petites et grandes compromissions, de l’appauvrissement du peuple : « La crise du pays transforme les individus en marchands de corruption, les denrées alimentaires de base sont devenues monnaie d’échange et objet de favoritisme. » C’est le règne des petits chefs auxquels « tu » résiste obstinément, se voyant agir comme s’il était spectateur de lui-même : « Tu vis une sorte de pièce de théâtre dans laquelle tu as le rôle de réceptionniste d’un hôtel minable, tu t’entends parler ». Le récit se termine par une aventure désopilante aux limites du tragique, comme la Roumanie de naguère en avait le secret.
« Promotion d’un pion » évoque le travail d’été d’un étudiant en sylviculture qui, pour gagner de l’argent, s’est fait engager pour trois mois au « Bureau de Tourisme pour la Jeunesse », accueillant des vacanciers venus visiter la belle ville de l’Église Noire entourée de montagnes et cherchant, pour une somme modique, à loger dans un foyer d’étudiants. Nous sommes au temps du « parti unique », des petites et grandes compromissions, de l’appauvrissement du peuple : « La crise du pays transforme les individus en marchands de corruption, les denrées alimentaires de base sont devenues monnaie d’échange et objet de favoritisme. » C’est le règne des petits chefs auxquels « tu » résiste obstinément, se voyant agir comme s’il était spectateur de lui-même : « Tu vis une sorte de pièce de théâtre dans laquelle tu as le rôle de réceptionniste d’un hôtel minable, tu t’entends parler ». Le récit se termine par une aventure désopilante aux limites du tragique, comme la Roumanie de naguère en avait le secret.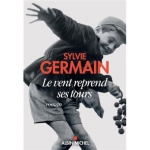 Lire, relire... Sylvie Germain, Le vent reprend ses tours, Albin Michel, 2019, Le livre de poche, 2021
Lire, relire... Sylvie Germain, Le vent reprend ses tours, Albin Michel, 2019, Le livre de poche, 2021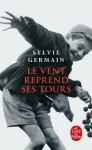 De nombreuses années plus tard, en 2015, alors que la morne vie de Nathan ne s’est pas remise de ce qu’il croyait être la mort de son « homme-oiseau » dans un accident de moto dont il se juge responsable, il apprend que Gavril, qui était resté en vie, vient de disparaître de l’hôpital où il végétait, et qu’il est mort noyé dans la Seine. Taraudé par le remords de n’avoir rien su, à cause d’un mensonge, pense-t-il, de sa mère, il entame une longue enquête rétrospective sur son vieil ami, grâce notamment aux enregistrements effectués par l’assistante sociale qui l’avait pris sous son aile. Son ascendance mi allemande mi tsigane, sa vie en Roumanie, l’oppression, le pénitencier, la fuite en France… Et voilà Nathan parti sur les traces de Gavril dans son pays d’origine : Timişoara et les villages du Banat, Bucarest, l’ « enfer carcéral » de Jilava, le Bărăgan, le delta du Danube… Autant de découvertes qui entrent en résonance avec ce que les deux amis avaient vécu ensemble.
De nombreuses années plus tard, en 2015, alors que la morne vie de Nathan ne s’est pas remise de ce qu’il croyait être la mort de son « homme-oiseau » dans un accident de moto dont il se juge responsable, il apprend que Gavril, qui était resté en vie, vient de disparaître de l’hôpital où il végétait, et qu’il est mort noyé dans la Seine. Taraudé par le remords de n’avoir rien su, à cause d’un mensonge, pense-t-il, de sa mère, il entame une longue enquête rétrospective sur son vieil ami, grâce notamment aux enregistrements effectués par l’assistante sociale qui l’avait pris sous son aile. Son ascendance mi allemande mi tsigane, sa vie en Roumanie, l’oppression, le pénitencier, la fuite en France… Et voilà Nathan parti sur les traces de Gavril dans son pays d’origine : Timişoara et les villages du Banat, Bucarest, l’ « enfer carcéral » de Jilava, le Bărăgan, le delta du Danube… Autant de découvertes qui entrent en résonance avec ce que les deux amis avaient vécu ensemble.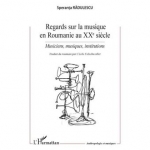 Speranţa Rădulescu, Regards sur la musique roumaine au XXe siècle. Musiciens, musiques, institutions, traduit du roumain par Cécile Folschweiller, L’Harmattan, 2021
Speranţa Rădulescu, Regards sur la musique roumaine au XXe siècle. Musiciens, musiques, institutions, traduit du roumain par Cécile Folschweiller, L’Harmattan, 2021 Horia Badescu, Celui qui reste debout, Éditions Petra, 2021
Horia Badescu, Celui qui reste debout, Éditions Petra, 2021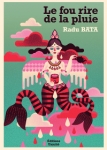 Radu Bata, Le fou rire de la pluie,
Radu Bata, Le fou rire de la pluie,