 Paul Paon / Paul Păun, Chimères, Métamorphoses, 2023
Paul Paon / Paul Păun, Chimères, Métamorphoses, 2023
Dans la première moitié du XXe siècle, la Roumanie fut le théâtre d’une grande effervescence culturelle, d’une intense activité avant-gardiste qui passa largement les frontières et apporta un souffle nouveau au monde de l’art. Légèrement après la génération de Tristan Tzara ou Benjamin Fondane, à côté de figures notoires comme celles de Ghérasim Luca ou Gellu Naum, Paul Păun (1915-1994) joua un rôle déterminant dans le renouveau artistique et intellectuel de cette période, dans son pays natal jusque dans les années 1950, puis en exil à l’étranger (Italie, Israël, avec des incursions en France, le pays dont il avait adopté la langue.)
 « Dessinateur, poète, écrivain, polémiste (mais aussi médecin et chirurgien) », devenu Paul Paon ou Paul Paon Zaharia après son départ de Roumanie, il fut l’un des membres fondateurs du groupe surréaliste de Bucarest (avec Ghérasim Luca, Gellu Naum, Trost, Virgil Teodorescu), et son œuvre écrite et graphique est marquée à la fois par cette appartenance et par une sensible singularité, d’où peut-être la discrétion avec laquelle elle s’est épanouie. Une exposition rétrospective, donnant une vision globale et néanmoins précise du travail de l’artiste, était donc salutaire – et la librairie Métamorphose s’est chargée de cette présentation, dont a été tiré un très beau catalogue intitulé Chimères, et dont la consultation donne des ouvertures infinies.
« Dessinateur, poète, écrivain, polémiste (mais aussi médecin et chirurgien) », devenu Paul Paon ou Paul Paon Zaharia après son départ de Roumanie, il fut l’un des membres fondateurs du groupe surréaliste de Bucarest (avec Ghérasim Luca, Gellu Naum, Trost, Virgil Teodorescu), et son œuvre écrite et graphique est marquée à la fois par cette appartenance et par une sensible singularité, d’où peut-être la discrétion avec laquelle elle s’est épanouie. Une exposition rétrospective, donnant une vision globale et néanmoins précise du travail de l’artiste, était donc salutaire – et la librairie Métamorphose s’est chargée de cette présentation, dont a été tiré un très beau catalogue intitulé Chimères, et dont la consultation donne des ouvertures infinies.
 Après une préface de Denis Moscovici et un parcours biographique de Monique Yaari mêlé de souvenirs (il était son oncle), et avant un bien utile tableau chronologique, quatre grandes sections composent l’ouvrage : la première et la plus importante (en longueur et en beauté), une vue significative et chronologique des dessins commentée par Radu Stern, spécialiste des avant-gardes ; puis une transcription du Carnet écrit par l’artiste entre 1984 et 1991, suivie de reproductions de livres, tracts, lettres et manuscrits donnant une idée fidèle de ses publications individuelles et collectives ; en troisième lieu, le rappel, documents à l’appui, d’expositions et de catalogues antérieurs (de Bucarest à Londres en passant par Tel-Aviv, Jaffa, Paris, Marseille etc.) ; enfin, des dessins, photographies et documents évoquant des souvenirs amoureux (avec des portraits de « Réni », sa femme) et amicaux (Ghérasim Luca et plusieurs autres).
Après une préface de Denis Moscovici et un parcours biographique de Monique Yaari mêlé de souvenirs (il était son oncle), et avant un bien utile tableau chronologique, quatre grandes sections composent l’ouvrage : la première et la plus importante (en longueur et en beauté), une vue significative et chronologique des dessins commentée par Radu Stern, spécialiste des avant-gardes ; puis une transcription du Carnet écrit par l’artiste entre 1984 et 1991, suivie de reproductions de livres, tracts, lettres et manuscrits donnant une idée fidèle de ses publications individuelles et collectives ; en troisième lieu, le rappel, documents à l’appui, d’expositions et de catalogues antérieurs (de Bucarest à Londres en passant par Tel-Aviv, Jaffa, Paris, Marseille etc.) ; enfin, des dessins, photographies et documents évoquant des souvenirs amoureux (avec des portraits de « Réni », sa femme) et amicaux (Ghérasim Luca et plusieurs autres).
Chimères suscitera la curiosité, le désir, l’intérêt tant des spécialistes que du grand public, à propos d’un artiste que cachèrent partiellement et involontairement les statures de certains de ses compagnons plus célèbres. La succession de dessins, de documents et d’écrits présente le cheminement d’un novateur qui, tout en restant fidèle à l’esprit de l’avant-garde surréaliste, a créé une œuvre originale : Radu Stern analyse finement la manière dont Paul Păun, « entièrement autodidacte en arts visuels », est passé de la « plastique » à ce que Trost appelle « l’aplastique », plus simplement d’images « reconnaissables » à des « images méconnaissables », dessins en mouvements, en traces et ombres entremêlées (selon un itinéraire, toutes précautions prises, à celui de Christian Dotremont avec ses logogrammes). Remarquable par sa densité et son esthétique, ce livre, plus qu’un catalogue, revêt toutes les dimensions d’une monographie artistique complète.
Jean-Pierre Longre
 Le Persil Journal
Le Persil Journal  Entre les deux, le foisonnement que l’on attend toujours du fameux journal grand format. Des proses réalistes ou non (Karine Yakim Pasquier, Odile Cornuz, Pauline Desnuelles, Philippe Veuve, Dania Miralles, Cornélia de Preux, Juliette Dezuari), du théâtre (Philippe Jeanloz), de la poésie bardée de citations (Marie Patrono, Anicée Willemin), des poèmes tendance haïkus (Philippe Fontannaz), des proses et des vers en alternance (Maud Armani)… Le tout est ponctué par un « Voyage en Suisse » photographique de Patrick Gilliéron Lopreno et par des lignes ambulantes de Marius Daniel Popescu en personne !
Entre les deux, le foisonnement que l’on attend toujours du fameux journal grand format. Des proses réalistes ou non (Karine Yakim Pasquier, Odile Cornuz, Pauline Desnuelles, Philippe Veuve, Dania Miralles, Cornélia de Preux, Juliette Dezuari), du théâtre (Philippe Jeanloz), de la poésie bardée de citations (Marie Patrono, Anicée Willemin), des poèmes tendance haïkus (Philippe Fontannaz), des proses et des vers en alternance (Maud Armani)… Le tout est ponctué par un « Voyage en Suisse » photographique de Patrick Gilliéron Lopreno et par des lignes ambulantes de Marius Daniel Popescu en personne !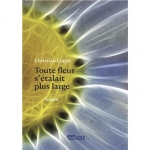 Christian Cogné, Toute fleur s’étalait plus large, Velvet, 2023
Christian Cogné, Toute fleur s’étalait plus large, Velvet, 2023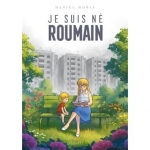 Daniel Horia, Je suis né roumain, éditions Paquet, 2023
Daniel Horia, Je suis né roumain, éditions Paquet, 2023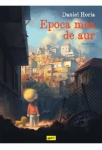 C’est d’ailleurs avec subtilité que l’auteur, qui devenu adulte a su ce qui s’est passé dans la famille et plus généralement dans la société roumaine des années 1980, laisse à l’enfant ses propres soucis d’enfant. Les souvenirs ne sont pas seulement factuels : ils sont ceux des rêves, des préoccupations, voire des soupçons d’un petit garçon. Avec le réalisme du vécu, un réalisme par moments teinté d’humour (voir par exemple la scène du restaurant où aucun des plats figurant sur la carte n’est disponible, ou l’accueil rébarbatif des employées de magasin), et avec une sensibilité teintée de discrétion, les complexités de la mémoire sont parfaitement rendues par la narration et les dialogues, ainsi que par les images colorées, lumineuses, souriantes, tendres, avec parfois de tragiques contrastes – le gris et le noir de la souffrance, les vifs éclats de la colère ou la brusquerie des catastrophes (celle de Tchernobyl, dont le nuage radioactif arrivant sur Bucarest ponctue l’album). Je suis né roumain est une belle autobiographie, qui éveillera la nostalgie ou les regrets de ceux qui ont vécu une enfance comparable, qui à d’autres apprendra un certain nombre de choses, et qui pour tous combine les plaisirs de la lecture graphique, historique, psychologique et littéraire.
C’est d’ailleurs avec subtilité que l’auteur, qui devenu adulte a su ce qui s’est passé dans la famille et plus généralement dans la société roumaine des années 1980, laisse à l’enfant ses propres soucis d’enfant. Les souvenirs ne sont pas seulement factuels : ils sont ceux des rêves, des préoccupations, voire des soupçons d’un petit garçon. Avec le réalisme du vécu, un réalisme par moments teinté d’humour (voir par exemple la scène du restaurant où aucun des plats figurant sur la carte n’est disponible, ou l’accueil rébarbatif des employées de magasin), et avec une sensibilité teintée de discrétion, les complexités de la mémoire sont parfaitement rendues par la narration et les dialogues, ainsi que par les images colorées, lumineuses, souriantes, tendres, avec parfois de tragiques contrastes – le gris et le noir de la souffrance, les vifs éclats de la colère ou la brusquerie des catastrophes (celle de Tchernobyl, dont le nuage radioactif arrivant sur Bucarest ponctue l’album). Je suis né roumain est une belle autobiographie, qui éveillera la nostalgie ou les regrets de ceux qui ont vécu une enfance comparable, qui à d’autres apprendra un certain nombre de choses, et qui pour tous combine les plaisirs de la lecture graphique, historique, psychologique et littéraire.  Le Haïdouc
Le Haïdouc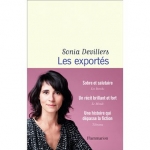 Sonia Devillers, Les exportés, Flammarion, 2022
Sonia Devillers, Les exportés, Flammarion, 2022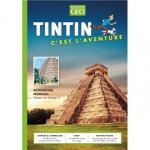 Tintin c’est l’aventure
Tintin c’est l’aventure Mais ce nouveau numéro de Tintin c’est l’aventure aborde bien d’autres thématiques concernant le patrimoine et des trésors en danger aussi divers que ceux qui figurent dans les albums d’Hergé. Monuments lointains ou proches, animaux exotiques, ruines diverses, musées, et aussi le château de Moulinsart (fortement inspiré de celui de Cheverny) amènent à poser des questions cruciales sur la notion de patrimoine (« construction sociale » selon la spécialiste Julie Deschepper), sur le tourisme de masse (genre « Joyeux Turlurons »), sur le drame que fut la déportation des Amérindiens – on en passe. C’est aussi l’occasion de lire une BD inédite d’Aude Mermillon et Louise Dupraz, et de découvrir, illustrations à l’appui, l’ « univers inimitable » du dessinateur-voyageur suisse Cosey.
Mais ce nouveau numéro de Tintin c’est l’aventure aborde bien d’autres thématiques concernant le patrimoine et des trésors en danger aussi divers que ceux qui figurent dans les albums d’Hergé. Monuments lointains ou proches, animaux exotiques, ruines diverses, musées, et aussi le château de Moulinsart (fortement inspiré de celui de Cheverny) amènent à poser des questions cruciales sur la notion de patrimoine (« construction sociale » selon la spécialiste Julie Deschepper), sur le tourisme de masse (genre « Joyeux Turlurons »), sur le drame que fut la déportation des Amérindiens – on en passe. C’est aussi l’occasion de lire une BD inédite d’Aude Mermillon et Louise Dupraz, et de découvrir, illustrations à l’appui, l’ « univers inimitable » du dessinateur-voyageur suisse Cosey. Ce volume, où alternent textes, interviews, images, poursuit l’exploration de l’univers de Tintin, une exploration variée, approfondie, toujours passionnante, jamais épuisée. Et un univers qui est d’abord, mentalement et artistiquement, celui d’Hergé, qui confia à Numa Sadoul : « Si je me suis mis à voyager ce n’est pas seulement pour voir de nouveaux paysages, mais pour découvrir d’autres modes de vie, d’autres façons de penser ; en somme pour élargir ma vision du monde. »
Ce volume, où alternent textes, interviews, images, poursuit l’exploration de l’univers de Tintin, une exploration variée, approfondie, toujours passionnante, jamais épuisée. Et un univers qui est d’abord, mentalement et artistiquement, celui d’Hergé, qui confia à Numa Sadoul : « Si je me suis mis à voyager ce n’est pas seulement pour voir de nouveaux paysages, mais pour découvrir d’autres modes de vie, d’autres façons de penser ; en somme pour élargir ma vision du monde. » Cahiers Benjamin Fondane n° 25, « Dialogues », 2022
Cahiers Benjamin Fondane n° 25, « Dialogues », 2022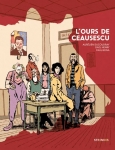 Aurélien Ducoudray, Gaël Henry, Paul Bona, L’ours de Ceauşescu, Steinkis, 2022
Aurélien Ducoudray, Gaël Henry, Paul Bona, L’ours de Ceauşescu, Steinkis, 2022 Lorsque l’histoire commence, la « révolution » gronde devant le palais présidentiel, le 21 décembre 1989, face à un dictateur dont le visage vu en gros plan se décompose à mesure que les huées augmentent. Malgré cela, il semble que la Securitate, l’impitoyable police politique, poursuit son « travail ». Apparaissent successivement, qui vont être enfermés ensemble : une jeune femme dont l’enfance a été marquée par une injustice flagrante, un jeune homme qui ne manie pas assez bien le champ lexical de la torture pour pouvoir entrer dans la police politique, un écrivain officiel et ouvertement flagorneur, un clown prestidigitateur, une femme de ménage fascinée par les innombrables et luxueuses chaussures d’Elena Ceauşescu, un policier maffieux, un rabatteur d’ours pour les chasses du « conducator ». Un échantillon aussi varié que pittoresque de la population roumaine à la fin des années 1980.
Lorsque l’histoire commence, la « révolution » gronde devant le palais présidentiel, le 21 décembre 1989, face à un dictateur dont le visage vu en gros plan se décompose à mesure que les huées augmentent. Malgré cela, il semble que la Securitate, l’impitoyable police politique, poursuit son « travail ». Apparaissent successivement, qui vont être enfermés ensemble : une jeune femme dont l’enfance a été marquée par une injustice flagrante, un jeune homme qui ne manie pas assez bien le champ lexical de la torture pour pouvoir entrer dans la police politique, un écrivain officiel et ouvertement flagorneur, un clown prestidigitateur, une femme de ménage fascinée par les innombrables et luxueuses chaussures d’Elena Ceauşescu, un policier maffieux, un rabatteur d’ours pour les chasses du « conducator ». Un échantillon aussi varié que pittoresque de la population roumaine à la fin des années 1980.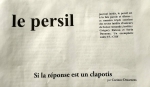 Sous la houlette de l’infatigable Marius Daniel Popescu, deux numéros triples du
Sous la houlette de l’infatigable Marius Daniel Popescu, deux numéros triples du  Le numéro précédent (mars 2022) « contient des textes inédits d’auteurs de Suisse romande », en prose ou en vers : Corinne Desarzens, François Hüssy, Philippe Veuve, Emilie Bilman, Jean-Luc Dépraz, Fiorenzino Iori, Esther Sarre, Vincent Yersin, Véronique Emmenegger, Adrian Rachieru, Matthieu Ruf, Valérie Gillard. Les dernières pages accueillent la poésie de deux invités : Grégory Rateau, qui est entre autres rédacteur en chef du Petit Journal de Bucarest, et Sorin Dananae (texte traduit du roumain par Marius Daniel Popescu). Depuis la Suisse, Marius Daniel Popescu reste toujours fidèle à sa Roumanie natale…
Le numéro précédent (mars 2022) « contient des textes inédits d’auteurs de Suisse romande », en prose ou en vers : Corinne Desarzens, François Hüssy, Philippe Veuve, Emilie Bilman, Jean-Luc Dépraz, Fiorenzino Iori, Esther Sarre, Vincent Yersin, Véronique Emmenegger, Adrian Rachieru, Matthieu Ruf, Valérie Gillard. Les dernières pages accueillent la poésie de deux invités : Grégory Rateau, qui est entre autres rédacteur en chef du Petit Journal de Bucarest, et Sorin Dananae (texte traduit du roumain par Marius Daniel Popescu). Depuis la Suisse, Marius Daniel Popescu reste toujours fidèle à sa Roumanie natale…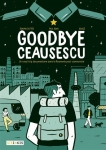 Romain Dutter (scénario), Bouqué (dessin), Paul Bona (couleurs), Goodbye Ceauşescu, « Un road-trip documentaire dans la Roumanie post-communiste », Steinkis, 2021
Romain Dutter (scénario), Bouqué (dessin), Paul Bona (couleurs), Goodbye Ceauşescu, « Un road-trip documentaire dans la Roumanie post-communiste », Steinkis, 2021 Six chapitres rythment cette visite. Après le premier (« Goodbye Ceauşescu ») qui résume l’histoire de la Roumanie (certaines de ses légendes aussi), les cinq suivants sont consacrés à de grandes étapes géographiques : les bords de la Mer Noire, de Constanţa au Delta du Danube, Bucarest, son éclectisme et sa vie animée, Timişoara, ville multiculturelle d’où est partie la « Révolution » de 1989, la Transylvanie, sa diversité ethnique et sa richesse historique, la Moldavie, sa campagne sereine et ses magnifiques monastères. Rien n’échappe à l’observation bienveillante des voyageurs qui, s’adressant au lecteur, espèrent que « cette lecture vous a plu et qu’elle vous a permis de renouveler la perception que vous aviez de la Roumanie et de sa population, de déconstruire certains clichés. »
Six chapitres rythment cette visite. Après le premier (« Goodbye Ceauşescu ») qui résume l’histoire de la Roumanie (certaines de ses légendes aussi), les cinq suivants sont consacrés à de grandes étapes géographiques : les bords de la Mer Noire, de Constanţa au Delta du Danube, Bucarest, son éclectisme et sa vie animée, Timişoara, ville multiculturelle d’où est partie la « Révolution » de 1989, la Transylvanie, sa diversité ethnique et sa richesse historique, la Moldavie, sa campagne sereine et ses magnifiques monastères. Rien n’échappe à l’observation bienveillante des voyageurs qui, s’adressant au lecteur, espèrent que « cette lecture vous a plu et qu’elle vous a permis de renouveler la perception que vous aviez de la Roumanie et de sa population, de déconstruire certains clichés. » Le but est atteint, puisque l’essentiel est dit et montré, paysages et monuments, mentalités et coutumes, charmes et imperfections, contrastes entre villes et campagnes, entre traditions et modernité, relations entre les communautés (Roumains, Hongrois, Tziganes…). Quelques documents photographiques et quelques considérations révélatrices de la manière dont les Roumains voient la France et les Français ponctuent cet ouvrage qui, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce séduisant pays, est une prometteuse invitation au voyage, et pour les autres une belle invitation à y retourner.
Le but est atteint, puisque l’essentiel est dit et montré, paysages et monuments, mentalités et coutumes, charmes et imperfections, contrastes entre villes et campagnes, entre traditions et modernité, relations entre les communautés (Roumains, Hongrois, Tziganes…). Quelques documents photographiques et quelques considérations révélatrices de la manière dont les Roumains voient la France et les Français ponctuent cet ouvrage qui, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce séduisant pays, est une prometteuse invitation au voyage, et pour les autres une belle invitation à y retourner.  Le Haïdouc
Le Haïdouc Cahiers Benjamin Fondane
Cahiers Benjamin Fondane
 « Promotion d’un pion » évoque le travail d’été d’un étudiant en sylviculture qui, pour gagner de l’argent, s’est fait engager pour trois mois au « Bureau de Tourisme pour la Jeunesse », accueillant des vacanciers venus visiter la belle ville de l’Église Noire entourée de montagnes et cherchant, pour une somme modique, à loger dans un foyer d’étudiants. Nous sommes au temps du « parti unique », des petites et grandes compromissions, de l’appauvrissement du peuple : « La crise du pays transforme les individus en marchands de corruption, les denrées alimentaires de base sont devenues monnaie d’échange et objet de favoritisme. » C’est le règne des petits chefs auxquels « tu » résiste obstinément, se voyant agir comme s’il était spectateur de lui-même : « Tu vis une sorte de pièce de théâtre dans laquelle tu as le rôle de réceptionniste d’un hôtel minable, tu t’entends parler ». Le récit se termine par une aventure désopilante aux limites du tragique, comme la Roumanie de naguère en avait le secret.
« Promotion d’un pion » évoque le travail d’été d’un étudiant en sylviculture qui, pour gagner de l’argent, s’est fait engager pour trois mois au « Bureau de Tourisme pour la Jeunesse », accueillant des vacanciers venus visiter la belle ville de l’Église Noire entourée de montagnes et cherchant, pour une somme modique, à loger dans un foyer d’étudiants. Nous sommes au temps du « parti unique », des petites et grandes compromissions, de l’appauvrissement du peuple : « La crise du pays transforme les individus en marchands de corruption, les denrées alimentaires de base sont devenues monnaie d’échange et objet de favoritisme. » C’est le règne des petits chefs auxquels « tu » résiste obstinément, se voyant agir comme s’il était spectateur de lui-même : « Tu vis une sorte de pièce de théâtre dans laquelle tu as le rôle de réceptionniste d’un hôtel minable, tu t’entends parler ». Le récit se termine par une aventure désopilante aux limites du tragique, comme la Roumanie de naguère en avait le secret.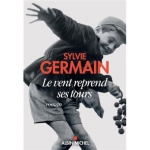 Lire, relire... Sylvie Germain, Le vent reprend ses tours, Albin Michel, 2019, Le livre de poche, 2021
Lire, relire... Sylvie Germain, Le vent reprend ses tours, Albin Michel, 2019, Le livre de poche, 2021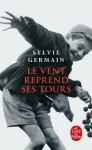 De nombreuses années plus tard, en 2015, alors que la morne vie de Nathan ne s’est pas remise de ce qu’il croyait être la mort de son « homme-oiseau » dans un accident de moto dont il se juge responsable, il apprend que Gavril, qui était resté en vie, vient de disparaître de l’hôpital où il végétait, et qu’il est mort noyé dans la Seine. Taraudé par le remords de n’avoir rien su, à cause d’un mensonge, pense-t-il, de sa mère, il entame une longue enquête rétrospective sur son vieil ami, grâce notamment aux enregistrements effectués par l’assistante sociale qui l’avait pris sous son aile. Son ascendance mi allemande mi tsigane, sa vie en Roumanie, l’oppression, le pénitencier, la fuite en France… Et voilà Nathan parti sur les traces de Gavril dans son pays d’origine : Timişoara et les villages du Banat, Bucarest, l’ « enfer carcéral » de Jilava, le Bărăgan, le delta du Danube… Autant de découvertes qui entrent en résonance avec ce que les deux amis avaient vécu ensemble.
De nombreuses années plus tard, en 2015, alors que la morne vie de Nathan ne s’est pas remise de ce qu’il croyait être la mort de son « homme-oiseau » dans un accident de moto dont il se juge responsable, il apprend que Gavril, qui était resté en vie, vient de disparaître de l’hôpital où il végétait, et qu’il est mort noyé dans la Seine. Taraudé par le remords de n’avoir rien su, à cause d’un mensonge, pense-t-il, de sa mère, il entame une longue enquête rétrospective sur son vieil ami, grâce notamment aux enregistrements effectués par l’assistante sociale qui l’avait pris sous son aile. Son ascendance mi allemande mi tsigane, sa vie en Roumanie, l’oppression, le pénitencier, la fuite en France… Et voilà Nathan parti sur les traces de Gavril dans son pays d’origine : Timişoara et les villages du Banat, Bucarest, l’ « enfer carcéral » de Jilava, le Bărăgan, le delta du Danube… Autant de découvertes qui entrent en résonance avec ce que les deux amis avaient vécu ensemble.