Le Persil Journal, présentation des numéros récents.
 Le Persil – n° 229-233 – Inédits
Le Persil – n° 229-233 – Inédits
Publié 22 avril 2025
Journal inédit, le persil est à la fois parole et silence ; ce numéro quintuple rassemble des textes de trente-trois auteur·ices de Suisse romande, dont plus de la moitié n’avait jamais publié dans ces pages auparavant, ainsi qu’une invitée : Alta Ifland. Il a été préparé et mis en page par Daniel Vuataz et coûte : CHF 25.- ou 25 euros.
Avril 2025, 72 pages.
Avec les contributions de Alain Rochat, Albert Anor, Alice Bottarelli, Alice Kübler & Ella Stürzenhofecker, Amélie Charcosset, Ann Schönenberg, Apolonia M.-E, Arthur Brügger, Benjamin Pécoud, Colin Pahlisch, Daniel Vuataz, Jean Savanes, Joan Suris, Linda Bühler, Lolvé Tillmanns, Lou Ciszewski, Manon Reith, Marilou Rytz, Marina Salzmann, Mathias Howald, Matthieu Ruf, Maxime Sacchetto, Myriam Wahli, Nathalie Garbely, Numa Francillon, Santiago Basurto, Sarah Marie, Sophie Dora Swan, Timba Bema, Typhaine Marc, Velia Ferracini, Vincent Yersin & l’invitée du persil Alta Iflan.
Avec le soutien des Amis du journal le persil.
 Le Persil – n° 234-236 – Contini
Le Persil – n° 234-236 – Contini
Publié 5 septembre 2025
Journal inédit, le persil est à la fois parole et silence ; ce numéro triple est le reflet d’amitiés littéraires tissées au fil des ans par Jean Christophe Contini en Suisse et en France ; il contient des illustrations, des textes et des poèmes pour la plupart inédits ou méconnus. Il a été préparé par Jean Christophe Contini et mis en page par Daniel Vuataz et coûte : 20 francs ou 20 euros.
Août 2025, 40 pages.
Avec les contributions de Jean Christophe Contini, Joseph Rouzel, Patrick Macquaire, Jean-François Gomez, Alain Borer, Éric Houser, Michèle Reverbel, Clément Porre, Babeth Fargier, Marie-Dominique Kessler, Martin Rueff, Nathalie Piégay, Virgile Novarina, Charles Dvořák, Francesco Deotto, Alain Froidevaux, MK.
Avec le soutien des Amis du journal le persil.
 Le Persil – n° 237-238 – Werner Renfer
Le Persil – n° 237-238 – Werner Renfer
Publié 17 octobre 2025
Journal inédit, le persil est à la fois parole et silence ; ce numéro double est un hommage à l’écrivain jurassien Werner Renfer (1898-1936), célèbre pour avoir inventé, aux côtés de Cendrars, Ramuz ou Roud, une nouvelle parole poétique dans la Suisse francophone. Il a été dirigé et orchestré par Patrick Amstutz, et il coûte : 10 francs ou 10 euros.
Septembre 2025, 28 pages.
Avec les contributions de Patrick Amstutz, Claude Darbellay, Thierry Raboud, Laurent Fourcaut, Françoise Matthey, François Debluë, Pierre Lafargue, Ferenc Rakoczy, Claudine Houriet, Edouard Choffat, Patrick Vallon, Jean Prétôt, Jean-Pierre Althaus, Claude Darras, Denis Mützenberg, Alexandre Voisard, Antoine Le Roy, Yari Bernasconi, et des textes de Werner Renfer.
Avec le soutien des Amis du journal le persil.
 Le Persil – n° 239 – Henri Roorda
Le Persil – n° 239 – Henri Roorda
Publié 27 octobre 2025
Journal inédit, le persil est à la fois parole et silence ; ce numéro simple contient des textes critiques, des impressions de lecture et des pastiches rassemblés à l’occasion du centenaire de la mort d’Henri Roorda, ainsi que des inédits et des documents iconographiques. Il a été préparé par Alain Ausoni & Anne-Lise Delacrétaz et coûte : 10 francs ou 10 euros.
Novembre 2025, 20 pages.
Avec les contributions de Joël Aguet Alain Ausoni, Félix Blandin, Jo Boegli, Alain Corbellari, Morgane Cuttat, Anne-Lise Delacrétaz, Ariel Dilon, Marianne Enckell, Sushmit Ganguly, Rokus Hofstede, Marguerite Lebeau, Gilles Losseroy, Aurélie Maire, Jérôme Meizoz, Lea Mento, Andréa Moret, Sophie Perrelet, Guy Poitry, Robin Vanat, Jonathan Wenger, Simon Weniger.
Avec le soutien des Amis du journal le persil.

 André Paléologue, Cécile Lauru. Le destin d’une compositrice française, de Nantes aux Carpates, Les cahiers de la société historique et archéologique des VIIIe et XVIIe arrondissements, numéro spécial, 2021.
André Paléologue, Cécile Lauru. Le destin d’une compositrice française, de Nantes aux Carpates, Les cahiers de la société historique et archéologique des VIIIe et XVIIe arrondissements, numéro spécial, 2021. Mais la rencontre de Vasile Georgescu Paleolog, le coup de foudre réciproque et le mariage changèrent l’orientation de sa vie. Son mari roumain, homme d’affaires, critique d’art, essayiste, était un ami de Constantin Brancuşi, spécialiste de son œuvre, et Cécile put ainsi fréquenter l’avant-garde de l’époque, artistes, hommes de lettres, musiciens, en particulier Erik Satie et le « groupe d’Arcueil ». « En 1921, selon les critères de l’époque, Cécile Lauru Paleolog était une femme comblée : mariée à un homme d’affaires de « bonne condition », mère de trois garçons en pleine forme, douée d’un potentiel créatif reconnu et admiré de son entourage… ». Elle suit son mari dans ses voyages professionnels, puis la famille part s’installer en Roumanie. Dépaysement total pour Cécile, qui va trouver une activité d’ethnomusicologue et continuer à créer, nourrissant ses compositions du « chant de l’Église orthodoxe » et du « folklore musical villageois », et qui durant cette période va composer, « dans un parfait esprit de liberté et de création », ses plus grandes œuvres. Puis c’est à nouveau Berlin pour l’éducation de ses enfants (1930-1940), l’expulsion par le régime nazi, le retour en Roumaine (Bucarest), avec « la musique comme dernier refuge » face aux brimades du régime totalitaire, la possibilité de revenir en France où elle meurt accidentellement en 1959.
Mais la rencontre de Vasile Georgescu Paleolog, le coup de foudre réciproque et le mariage changèrent l’orientation de sa vie. Son mari roumain, homme d’affaires, critique d’art, essayiste, était un ami de Constantin Brancuşi, spécialiste de son œuvre, et Cécile put ainsi fréquenter l’avant-garde de l’époque, artistes, hommes de lettres, musiciens, en particulier Erik Satie et le « groupe d’Arcueil ». « En 1921, selon les critères de l’époque, Cécile Lauru Paleolog était une femme comblée : mariée à un homme d’affaires de « bonne condition », mère de trois garçons en pleine forme, douée d’un potentiel créatif reconnu et admiré de son entourage… ». Elle suit son mari dans ses voyages professionnels, puis la famille part s’installer en Roumanie. Dépaysement total pour Cécile, qui va trouver une activité d’ethnomusicologue et continuer à créer, nourrissant ses compositions du « chant de l’Église orthodoxe » et du « folklore musical villageois », et qui durant cette période va composer, « dans un parfait esprit de liberté et de création », ses plus grandes œuvres. Puis c’est à nouveau Berlin pour l’éducation de ses enfants (1930-1940), l’expulsion par le régime nazi, le retour en Roumaine (Bucarest), avec « la musique comme dernier refuge » face aux brimades du régime totalitaire, la possibilité de revenir en France où elle meurt accidentellement en 1959. André Paléologue, historien, petit-fils de Cécile Lauru, était bien placé pour écrire l’histoire de cette musicienne trop méconnue, qui mérite amplement une réhabilitation, elle qui a tenté une « synthèse sonore européenne ». Son ouvrage, fortement documenté, illustré de photos probantes, raconte certes en détail la vie particulièrement remplie de sa grand-mère (qui soit dit en passant avait un caractère bien trempé), en s’appuyant en partie sur les 586 pages manuscrites de ses Souvenirs. Mais il va au-delà : il révèle tout un pan de la musique européenne du XXe siècle, sans se priver de faire quelques apartés, par exemple sur le piano qui a suivi la musicienne dans toutes ses pérégrinations, ni de poser quelques questions ou d’émettre quelques réflexions, par exemple sur la correspondance des arts (musique, littérature, peinture, sculpture…), ou sur le fait de savoir si l’on peut « circonscrire l’espace d’une musique spécifiquement roumaine » (question qui taraudait V. G. Paleolog), ou encore si l’on peut créer, comme le tenta Georges Enesco, une « musique moderne et nationale. » Ainsi, ces pages suscitent l’intérêt à plusieurs titres (biographique, musicologique, historique, critique), et mettent en lumière non seulement l’existence d’une grande figure artistique, mais beaucoup de questions relatives à la vie culturelle européenne.
André Paléologue, historien, petit-fils de Cécile Lauru, était bien placé pour écrire l’histoire de cette musicienne trop méconnue, qui mérite amplement une réhabilitation, elle qui a tenté une « synthèse sonore européenne ». Son ouvrage, fortement documenté, illustré de photos probantes, raconte certes en détail la vie particulièrement remplie de sa grand-mère (qui soit dit en passant avait un caractère bien trempé), en s’appuyant en partie sur les 586 pages manuscrites de ses Souvenirs. Mais il va au-delà : il révèle tout un pan de la musique européenne du XXe siècle, sans se priver de faire quelques apartés, par exemple sur le piano qui a suivi la musicienne dans toutes ses pérégrinations, ni de poser quelques questions ou d’émettre quelques réflexions, par exemple sur la correspondance des arts (musique, littérature, peinture, sculpture…), ou sur le fait de savoir si l’on peut « circonscrire l’espace d’une musique spécifiquement roumaine » (question qui taraudait V. G. Paleolog), ou encore si l’on peut créer, comme le tenta Georges Enesco, une « musique moderne et nationale. » Ainsi, ces pages suscitent l’intérêt à plusieurs titres (biographique, musicologique, historique, critique), et mettent en lumière non seulement l’existence d’une grande figure artistique, mais beaucoup de questions relatives à la vie culturelle européenne.  Le Persil Journal
Le Persil Journal Le Persil Journal
Le Persil Journal  Entre les deux, le foisonnement que l’on attend toujours du fameux journal grand format. Des proses réalistes ou non (Karine Yakim Pasquier, Odile Cornuz, Pauline Desnuelles, Philippe Veuve, Dania Miralles, Cornélia de Preux, Juliette Dezuari), du théâtre (Philippe Jeanloz), de la poésie bardée de citations (Marie Patrono, Anicée Willemin), des poèmes tendance haïkus (Philippe Fontannaz), des proses et des vers en alternance (Maud Armani)… Le tout est ponctué par un « Voyage en Suisse » photographique de Patrick Gilliéron Lopreno et par des lignes ambulantes de Marius Daniel Popescu en personne !
Entre les deux, le foisonnement que l’on attend toujours du fameux journal grand format. Des proses réalistes ou non (Karine Yakim Pasquier, Odile Cornuz, Pauline Desnuelles, Philippe Veuve, Dania Miralles, Cornélia de Preux, Juliette Dezuari), du théâtre (Philippe Jeanloz), de la poésie bardée de citations (Marie Patrono, Anicée Willemin), des poèmes tendance haïkus (Philippe Fontannaz), des proses et des vers en alternance (Maud Armani)… Le tout est ponctué par un « Voyage en Suisse » photographique de Patrick Gilliéron Lopreno et par des lignes ambulantes de Marius Daniel Popescu en personne ! Le Haïdouc
Le Haïdouc Cahiers Benjamin Fondane n° 25, « Dialogues », 2022
Cahiers Benjamin Fondane n° 25, « Dialogues », 2022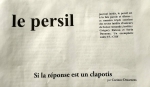 Sous la houlette de l’infatigable Marius Daniel Popescu, deux numéros triples du
Sous la houlette de l’infatigable Marius Daniel Popescu, deux numéros triples du  Le numéro précédent (mars 2022) « contient des textes inédits d’auteurs de Suisse romande », en prose ou en vers : Corinne Desarzens, François Hüssy, Philippe Veuve, Emilie Bilman, Jean-Luc Dépraz, Fiorenzino Iori, Esther Sarre, Vincent Yersin, Véronique Emmenegger, Adrian Rachieru, Matthieu Ruf, Valérie Gillard. Les dernières pages accueillent la poésie de deux invités : Grégory Rateau, qui est entre autres rédacteur en chef du Petit Journal de Bucarest, et Sorin Dananae (texte traduit du roumain par Marius Daniel Popescu). Depuis la Suisse, Marius Daniel Popescu reste toujours fidèle à sa Roumanie natale…
Le numéro précédent (mars 2022) « contient des textes inédits d’auteurs de Suisse romande », en prose ou en vers : Corinne Desarzens, François Hüssy, Philippe Veuve, Emilie Bilman, Jean-Luc Dépraz, Fiorenzino Iori, Esther Sarre, Vincent Yersin, Véronique Emmenegger, Adrian Rachieru, Matthieu Ruf, Valérie Gillard. Les dernières pages accueillent la poésie de deux invités : Grégory Rateau, qui est entre autres rédacteur en chef du Petit Journal de Bucarest, et Sorin Dananae (texte traduit du roumain par Marius Daniel Popescu). Depuis la Suisse, Marius Daniel Popescu reste toujours fidèle à sa Roumanie natale… Le Haïdouc
Le Haïdouc Cahiers Benjamin Fondane
Cahiers Benjamin Fondane
 « Promotion d’un pion » évoque le travail d’été d’un étudiant en sylviculture qui, pour gagner de l’argent, s’est fait engager pour trois mois au « Bureau de Tourisme pour la Jeunesse », accueillant des vacanciers venus visiter la belle ville de l’Église Noire entourée de montagnes et cherchant, pour une somme modique, à loger dans un foyer d’étudiants. Nous sommes au temps du « parti unique », des petites et grandes compromissions, de l’appauvrissement du peuple : « La crise du pays transforme les individus en marchands de corruption, les denrées alimentaires de base sont devenues monnaie d’échange et objet de favoritisme. » C’est le règne des petits chefs auxquels « tu » résiste obstinément, se voyant agir comme s’il était spectateur de lui-même : « Tu vis une sorte de pièce de théâtre dans laquelle tu as le rôle de réceptionniste d’un hôtel minable, tu t’entends parler ». Le récit se termine par une aventure désopilante aux limites du tragique, comme la Roumanie de naguère en avait le secret.
« Promotion d’un pion » évoque le travail d’été d’un étudiant en sylviculture qui, pour gagner de l’argent, s’est fait engager pour trois mois au « Bureau de Tourisme pour la Jeunesse », accueillant des vacanciers venus visiter la belle ville de l’Église Noire entourée de montagnes et cherchant, pour une somme modique, à loger dans un foyer d’étudiants. Nous sommes au temps du « parti unique », des petites et grandes compromissions, de l’appauvrissement du peuple : « La crise du pays transforme les individus en marchands de corruption, les denrées alimentaires de base sont devenues monnaie d’échange et objet de favoritisme. » C’est le règne des petits chefs auxquels « tu » résiste obstinément, se voyant agir comme s’il était spectateur de lui-même : « Tu vis une sorte de pièce de théâtre dans laquelle tu as le rôle de réceptionniste d’un hôtel minable, tu t’entends parler ». Le récit se termine par une aventure désopilante aux limites du tragique, comme la Roumanie de naguère en avait le secret. Norman Manea, Le retour du hooligan,
Norman Manea, Le retour du hooligan,  Nicoleta Esinencu, L'Évangile selon Marie – Trilogie, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, L’Arche, 2021
Nicoleta Esinencu, L'Évangile selon Marie – Trilogie, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, L’Arche, 2021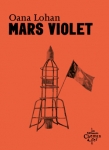 Oana Lohan, Mars violet, Les éditions du chemin de fer, 2021
Oana Lohan, Mars violet, Les éditions du chemin de fer, 2021 Florina Ilis, Le livre des nombres, traduit du roumain par Marily Le Nir, Éditions des Syrtes, 2021
Florina Ilis, Le livre des nombres, traduit du roumain par Marily Le Nir, Éditions des Syrtes, 2021 Le Persil
Le Persil Pour une fois, en déployant les ailes du Persil (drôle d’image, pourtant appelée par l’envergure des pages de ce journal hors normes), les lecteurs y trouvent uniquement du Marius Daniel Popescu. Et il n’y a
Pour une fois, en déployant les ailes du Persil (drôle d’image, pourtant appelée par l’envergure des pages de ce journal hors normes), les lecteurs y trouvent uniquement du Marius Daniel Popescu. Et il n’y a  Et voilà la grande affaire : les mots, qui vivent et qui donnent la vie, qui ont leur « territoire de chasse ». Le festin proposé par Marius Daniel Popescu se termine, en guise de digestif, par une série de courts poèmes tels qu’il en a le secret, au centre desquels trône justement le mot « MOT », qui donne des rendez-vous à ses congénères. « Ensemble, ils forment de petits groupes », et notre auteur, narrateur et poète tout uniment, a le don de les aider dans leurs démarches – ce qui nous permet de lire des images belles et surprenantes, telle celle-ci, prise au hasard : « La dame âgée d’en face était une feuille morte encore attachée à la branche de son thé. ». La forêt, la vie… Vraiment, si comme il l’écrit dans l’un de ses poèmes, « le persil appelle au travail », la récolte est une réussite absolue.
Et voilà la grande affaire : les mots, qui vivent et qui donnent la vie, qui ont leur « territoire de chasse ». Le festin proposé par Marius Daniel Popescu se termine, en guise de digestif, par une série de courts poèmes tels qu’il en a le secret, au centre desquels trône justement le mot « MOT », qui donne des rendez-vous à ses congénères. « Ensemble, ils forment de petits groupes », et notre auteur, narrateur et poète tout uniment, a le don de les aider dans leurs démarches – ce qui nous permet de lire des images belles et surprenantes, telle celle-ci, prise au hasard : « La dame âgée d’en face était une feuille morte encore attachée à la branche de son thé. ». La forêt, la vie… Vraiment, si comme il l’écrit dans l’un de ses poèmes, « le persil appelle au travail », la récolte est une réussite absolue. 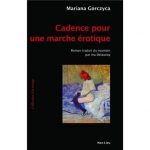 Mariana Gorczyca, Cadence pour une marche érotique. Roman traduit du roumain par Ina Delaunay, éditions Non Lieu, 2019
Mariana Gorczyca, Cadence pour une marche érotique. Roman traduit du roumain par Ina Delaunay, éditions Non Lieu, 2019  Luminitza C. Tigirlas, Fileuse de l'invisible — Marina Tsvetaeva,
Luminitza C. Tigirlas, Fileuse de l'invisible — Marina Tsvetaeva,  Cahiers Benjamin Fondane n° 22. « Pourquoi l'art - Chimériques esthétiques ».
Cahiers Benjamin Fondane n° 22. « Pourquoi l'art - Chimériques esthétiques ».