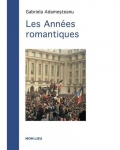 Gabriela Adameşteanu, Les Années romantiques, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, préface de Jean-Yves Potel, éditions Non Lieu, 2019
Gabriela Adameşteanu, Les Années romantiques, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, préface de Jean-Yves Potel, éditions Non Lieu, 2019
« Ce livre parle de moi, mais en l’écrivant j’espère bien que d’autres se reconnaîtront dans mes expériences, dans ce qu’il m’a été donné de vivre. ». La lecture de l’ouvrage nous montre, en effet, comment une écriture particulière peut largement transcender l’autobiographie, le récit personnel, pour offrir une vision à la fois générale et précise, une véritable somme historique, politique, sociologique, tout en ménageant l’intérêt narratif. Car le récit de ces « années romantiques » (expression à prendre sans doute avec un sourire de lucidité), de ces années qui ont accompagné et suivi ce que d’aucuns appellent « révolution », que Gabriela Adameşteanu, avec beaucoup d’autres, qualifie de « coup d’État », ce récit, donc, tient aussi bien de la littérature que de l’essai.
De nombreux fils tissent le texte, certains plus serrés que les autres. Cela commence par l’invitation faite à l’auteure par l’« International Writing Program » pour une résidence à Iowa City, quelques semaines au cours desquelles s’ouvre à elle cette Amérique dont elle ne rêvait pas vraiment (la France l’attirait plus), mais des semaines qui lui permettront, en particulier, d’interviewer à Chicago le dissident et disciple de Mircea Eliade Ioan Petru Culianu, réfugié aux USA après maintes tribulations, esprit particulièrement vif et réfléchi, homme d’une grande culture, qui mourra étrangement assassiné quelques semaines après cet entretien, non sans avoir fait découvrir à l’auteure et aux personnes qui le liront dans le journal d’opposition 22 le rôle meurtrier des manipulations du KGB, de la Securitate et des dirigeants communistes roumains dans un « scénario » destiné à chasser Ceauşescu, fin 1989, en faisant croire à une révolution populaire.
Autres fils conducteurs : l’accident survenu en février 1991 dans le Maramureş, en compagnie d’Emil Constantinescu (futur président d’« alternance » en 1996), accident qui vaudra à l’auteure de rester alitée plusieurs mois et de laisser libre cours à ses réflexions et à ses doutes ; le travail acharné pour l’organe du G.D.S. (« Groupe pour le dialogue social »), le journal 22, qu’elle a dirigé de 1991 à 2005 ; et, liée à cela, la contestation de la prise du pouvoir par Ion Iliescu, Petre Roman et quelques autres anciens dirigeants du parti communiste roumain – ce qui l’a conduite, comme la plupart des écrivains de l’époque, à laisser de côté la création : « Jusqu’en l’an 2000, environ, je n’ai plus écrit ni lu de prose : seulement la presse, roumaine ou étrangère, et des livres se rapportant de près ou de loin au journalisme. Quand j’échappais à l’obsession du journal, d’ordinaire pendant de courts voyages qui me conduisaient à des séminaires de presse, je prenais, sans projet précis, des notes, dans divers cahiers. ».
D’ailleurs, si plusieurs questions parcourent le livre (le rôle des politiciens dans la conduite des affaires et le destin du pays, le passé de la Roumanie avec ses compromissions, avec l’antisémitisme dont fut accusé, par exemple, Mircea Eliade, avec l’accession en force des communistes au pouvoir, avec les méfaits de la dictature sur les consciences et les relations humaines etc.), celle de l’engagement, de l’activité ou de la passivité des écrivains est récurrente. « Jusqu’où un écrivain peut-il aller dans les compromis, dans la vie, en littérature, dans le journalisme, et à partir de quel moment ces compromis affectent-ils la qualité de son écriture ? Si c’est bien le cas ? Sur ces questions, les verdicts sont plus nombreux que les débats. Les jeunes générations n’ont pas les moyens de comprendre la vie sous un régime totalitaire mieux que les citoyens des pays occidentaux qui n’ont pas fait cette expérience. À moi aussi il est arrivé d’émettre des jugements tranchés, sans nuances, avec cette condescendance, pour ne pas dire ce mépris, biologique, des jeunes envers la génération antérieure. J’ai longtemps repoussé in corpore les écrivains du réalisme socialiste, eux et toutes leurs œuvres. ». Un livre ponctué d’interrogations, donc, et qui décrit avec acuité, sans occulter ni les options ni les doutes personnels, la vie politique, intellectuelle, culturelle, littéraire d’une période tourmentée. Un livre où l’on croise beaucoup de personnalités marquantes ; pour n’en citer que quelques-unes : Paul Goma, exilé à Paris, la poétesse Ana Blandiana, figure, avec son mari Romulus Rusan, de l’Alliance Civique, I.P.Culianu déjà cité, Dumitru Ţepeneag, lui aussi exilé à Paris après avoir créé à Bucarest le groupe oniriste, Emil Constantinescu, Mircea Căratărescu, l’un des grands représentants avec Gabriela Adameşteanu de la littérature roumaine contemporaine, et qui séjourna en même temps qu’elle à Iowa City… Les noms foisonnent, les personnages abondent. Mais Les Années romantiques n’est pas une galerie de portraits, ni, seulement, une autobiographie ou un essai historico-politique. C’est vraiment une œuvre d’écrivain, dont la construction suit les méandres de la mémoire et de la vie personnelle et collective, rendant ainsi compte d’une période difficile.
Ajoutons que, à l’appui de cette construction mémorielle, le livre est un véritable traité d’anti-manichéisme : « La vie et la littérature ont contredit mon manichéisme. Mais il a résisté aux années romantiques. Dès mon enfance, j’ai senti qu’il était très mal d’“écrire pour le Parti”. J’ai atteint la liberté sans avoir “péché” par la moindre ligne de compromission, mais en portant toujours en moi, inversé, le manichéisme de mon éducation communiste. Il m’a fallu bien des années pour en sortir – si j’en suis vraiment sortie. […] Dans ce communisme qui a englouti les vies de nos parents et qui semblait prêt à durer plus longtemps que nos propres vies, une autre catégorie de gens a existé, beaucoup plus large : ceux qui s’efforçaient de mener une vie normale, en ne faisant que les compromis inévitables. Cette appréhension d’un monde disparu est plus complexe et moins intéressante pour ceux qui ne l’ont pas vécu – les Occidentaux et la majorité des jeunes d’aujourd’hui. ». C’est à cette « appréhension » « moins intéressante » que nous devons nous intéresser, et que doit nous intéresser la littérature, en nous mettant au cœur de la « complexité » de la vie.
Jean-Pierre Longre
www.editionsnonlieu.fr
 Cioran, archives paradoxales. Nouvelles approches critiques, Tome IV. Sous la direction d’Aurélien Demars et Mihaela-Genţiana Stănişor, Classiques Garnier, 2019
Cioran, archives paradoxales. Nouvelles approches critiques, Tome IV. Sous la direction d’Aurélien Demars et Mihaela-Genţiana Stănişor, Classiques Garnier, 2019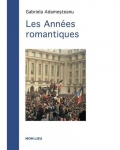 Gabriela Adameşteanu, Les Années romantiques, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, préface de Jean-Yves Potel, éditions Non Lieu, 2019
Gabriela Adameşteanu, Les Années romantiques, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, préface de Jean-Yves Potel, éditions Non Lieu, 2019 

 Benjamin Fondane, Paysages, poèmes 1917-1923 traduits du roumain par Odile Serre. Préface de Mircea Martin, avant-propos de Monique Jutrin. Le temps qu’il fait, 2019.
Benjamin Fondane, Paysages, poèmes 1917-1923 traduits du roumain par Odile Serre. Préface de Mircea Martin, avant-propos de Monique Jutrin. Le temps qu’il fait, 2019. 




 Lucian Blaga, În marea trecere / Dans le grand passage, édition bilingue. Traduction du roumain et avant-propos par Jean Poncet, postface par Horia Bădescu. Jacques André éditeur / Editura Şcoala Ardeleană, 2018
Lucian Blaga, În marea trecere / Dans le grand passage, édition bilingue. Traduction du roumain et avant-propos par Jean Poncet, postface par Horia Bădescu. Jacques André éditeur / Editura Şcoala Ardeleană, 2018
 Cornelia Petrescu, L’Écho de la lumière, Edilivre, 2018
Cornelia Petrescu, L’Écho de la lumière, Edilivre, 2018  Petre Raileanu, Les avant-gardes en Roumanie, La charrette et le cheval-vapeur, éditions Non Lieu, 2018
Petre Raileanu, Les avant-gardes en Roumanie, La charrette et le cheval-vapeur, éditions Non Lieu, 2018 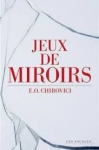 E. O. Chirovici, Jeux de miroirs, traduit de l’anglais par Isabelle Maillet, Les Escales, 2017, Pocket, 2018
E. O. Chirovici, Jeux de miroirs, traduit de l’anglais par Isabelle Maillet, Les Escales, 2017, Pocket, 2018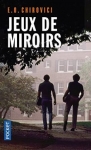 On sait par la « note de l’auteur finale » que celui-ci a publié plusieurs livres en roumain dans son pays d’origine, et que Jeux de miroirs est son premier roman écrit en anglais. L’adaptation à un nouveau contexte et à une nouvelle langue est réussie (pour autant qu’on puisse en juger sur une traduction). L’atmosphère des universités américaines dans les années 1980, par exemple, est rendue avec beaucoup de réalisme. Surtout, si ce roman est un bon thriller (avec sa dose de mystères et de péripéties), il n’est pas que cela : la psychologie des personnages, le jeu des vérités relatives, le travail de construction labyrinthique y sont primordiaux. Fions-nous aux intentions avouées par E. O. Chirovici lui-même : « Je dirais que mon livre s’attache moins au qui qu’au pourquoi. J’ai toujours pensé qu’au bout de trois cents pages les lecteurs méritaient d’en savoir plus que le seul nom de l’assassin, même obtenu après quantité de rebondissements inattendus. ».
On sait par la « note de l’auteur finale » que celui-ci a publié plusieurs livres en roumain dans son pays d’origine, et que Jeux de miroirs est son premier roman écrit en anglais. L’adaptation à un nouveau contexte et à une nouvelle langue est réussie (pour autant qu’on puisse en juger sur une traduction). L’atmosphère des universités américaines dans les années 1980, par exemple, est rendue avec beaucoup de réalisme. Surtout, si ce roman est un bon thriller (avec sa dose de mystères et de péripéties), il n’est pas que cela : la psychologie des personnages, le jeu des vérités relatives, le travail de construction labyrinthique y sont primordiaux. Fions-nous aux intentions avouées par E. O. Chirovici lui-même : « Je dirais que mon livre s’attache moins au qui qu’au pourquoi. J’ai toujours pensé qu’au bout de trois cents pages les lecteurs méritaient d’en savoir plus que le seul nom de l’assassin, même obtenu après quantité de rebondissements inattendus. ».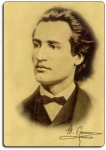

 Parmi les grands, figure en bonne place le Prix Nobel de Littérature 2009,
Parmi les grands, figure en bonne place le Prix Nobel de Littérature 2009, 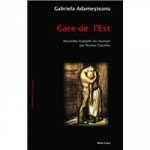 Gabriela Adameşteanu, Gare de l’Est. Nouvelles traduites du roumain par Nicolas Cavaillès, éditions Non Lieu, 2018.
Gabriela Adameşteanu, Gare de l’Est. Nouvelles traduites du roumain par Nicolas Cavaillès, éditions Non Lieu, 2018. Benjamin Fondane, Devant l’Histoire, textes réunis et présentés par Monique Jutrin, éditions de l’éclat, 2018
Benjamin Fondane, Devant l’Histoire, textes réunis et présentés par Monique Jutrin, éditions de l’éclat, 2018 Parution à signaler
Parution à signaler Le Club | Ana Blandiana
Le Club | Ana Blandiana « MA PATRIE A4 » (
« MA PATRIE A4 » ( George Vulturescu, Les Pierres du Nord, recueil bilingue, traduit du roumain par Jean Poncet, e
George Vulturescu, Les Pierres du Nord, recueil bilingue, traduit du roumain par Jean Poncet, e