Le Persil Journal, présentation des numéros récents.
 Le Persil – n° 229-233 – Inédits
Le Persil – n° 229-233 – Inédits
Publié 22 avril 2025
Journal inédit, le persil est à la fois parole et silence ; ce numéro quintuple rassemble des textes de trente-trois auteur·ices de Suisse romande, dont plus de la moitié n’avait jamais publié dans ces pages auparavant, ainsi qu’une invitée : Alta Ifland. Il a été préparé et mis en page par Daniel Vuataz et coûte : CHF 25.- ou 25 euros.
Avril 2025, 72 pages.
Avec les contributions de Alain Rochat, Albert Anor, Alice Bottarelli, Alice Kübler & Ella Stürzenhofecker, Amélie Charcosset, Ann Schönenberg, Apolonia M.-E, Arthur Brügger, Benjamin Pécoud, Colin Pahlisch, Daniel Vuataz, Jean Savanes, Joan Suris, Linda Bühler, Lolvé Tillmanns, Lou Ciszewski, Manon Reith, Marilou Rytz, Marina Salzmann, Mathias Howald, Matthieu Ruf, Maxime Sacchetto, Myriam Wahli, Nathalie Garbely, Numa Francillon, Santiago Basurto, Sarah Marie, Sophie Dora Swan, Timba Bema, Typhaine Marc, Velia Ferracini, Vincent Yersin & l’invitée du persil Alta Iflan.
Avec le soutien des Amis du journal le persil.
 Le Persil – n° 234-236 – Contini
Le Persil – n° 234-236 – Contini
Publié 5 septembre 2025
Journal inédit, le persil est à la fois parole et silence ; ce numéro triple est le reflet d’amitiés littéraires tissées au fil des ans par Jean Christophe Contini en Suisse et en France ; il contient des illustrations, des textes et des poèmes pour la plupart inédits ou méconnus. Il a été préparé par Jean Christophe Contini et mis en page par Daniel Vuataz et coûte : 20 francs ou 20 euros.
Août 2025, 40 pages.
Avec les contributions de Jean Christophe Contini, Joseph Rouzel, Patrick Macquaire, Jean-François Gomez, Alain Borer, Éric Houser, Michèle Reverbel, Clément Porre, Babeth Fargier, Marie-Dominique Kessler, Martin Rueff, Nathalie Piégay, Virgile Novarina, Charles Dvořák, Francesco Deotto, Alain Froidevaux, MK.
Avec le soutien des Amis du journal le persil.
 Le Persil – n° 237-238 – Werner Renfer
Le Persil – n° 237-238 – Werner Renfer
Publié 17 octobre 2025
Journal inédit, le persil est à la fois parole et silence ; ce numéro double est un hommage à l’écrivain jurassien Werner Renfer (1898-1936), célèbre pour avoir inventé, aux côtés de Cendrars, Ramuz ou Roud, une nouvelle parole poétique dans la Suisse francophone. Il a été dirigé et orchestré par Patrick Amstutz, et il coûte : 10 francs ou 10 euros.
Septembre 2025, 28 pages.
Avec les contributions de Patrick Amstutz, Claude Darbellay, Thierry Raboud, Laurent Fourcaut, Françoise Matthey, François Debluë, Pierre Lafargue, Ferenc Rakoczy, Claudine Houriet, Edouard Choffat, Patrick Vallon, Jean Prétôt, Jean-Pierre Althaus, Claude Darras, Denis Mützenberg, Alexandre Voisard, Antoine Le Roy, Yari Bernasconi, et des textes de Werner Renfer.
Avec le soutien des Amis du journal le persil.
 Le Persil – n° 239 – Henri Roorda
Le Persil – n° 239 – Henri Roorda
Publié 27 octobre 2025
Journal inédit, le persil est à la fois parole et silence ; ce numéro simple contient des textes critiques, des impressions de lecture et des pastiches rassemblés à l’occasion du centenaire de la mort d’Henri Roorda, ainsi que des inédits et des documents iconographiques. Il a été préparé par Alain Ausoni & Anne-Lise Delacrétaz et coûte : 10 francs ou 10 euros.
Novembre 2025, 20 pages.
Avec les contributions de Joël Aguet Alain Ausoni, Félix Blandin, Jo Boegli, Alain Corbellari, Morgane Cuttat, Anne-Lise Delacrétaz, Ariel Dilon, Marianne Enckell, Sushmit Ganguly, Rokus Hofstede, Marguerite Lebeau, Gilles Losseroy, Aurélie Maire, Jérôme Meizoz, Lea Mento, Andréa Moret, Sophie Perrelet, Guy Poitry, Robin Vanat, Jonathan Wenger, Simon Weniger.
Avec le soutien des Amis du journal le persil.
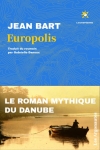 Lire, relire... Jean Bart, Europolis, traduit du roumain par Gabrielle Danoux, 2016, réédition Les Argonautes, 2025
Lire, relire... Jean Bart, Europolis, traduit du roumain par Gabrielle Danoux, 2016, réédition Les Argonautes, 2025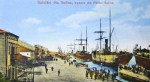 Là, entre bistrots et quais, entre maisons bourgeoises et taudis, tous, notables comme prolétaires, attendent l’arrivée du frère de Stamati, « l’Américain », qui en tant que tel doit forcément être riche et est accueilli en héros. Las ! Nicula Marulis, sur qui étaient fondés tous les espoirs de richesse et de développement, s’avère être un ancien bagnard de Cayenne qui pour tout bien ramène sa fille Evantia, jeune et magnifique métisse, qui va faire tourner la tête des hommes et crever de jalousie les dames. Vont s’ensuivre diverses aventures accompagnées de rumeurs, de secrets plus ou moins dévoilés, de coups de théâtre, d’idylles et de tragédies amoureuses, dans la tradition du drame populaire – d'où l’humour toutefois n’est pas absent, ne serait-ce que par le burlesque de certaines scènes, par la satire sociale ou par quelques plaisanteries teintées d’une misogynie à prendre au second degré.
Là, entre bistrots et quais, entre maisons bourgeoises et taudis, tous, notables comme prolétaires, attendent l’arrivée du frère de Stamati, « l’Américain », qui en tant que tel doit forcément être riche et est accueilli en héros. Las ! Nicula Marulis, sur qui étaient fondés tous les espoirs de richesse et de développement, s’avère être un ancien bagnard de Cayenne qui pour tout bien ramène sa fille Evantia, jeune et magnifique métisse, qui va faire tourner la tête des hommes et crever de jalousie les dames. Vont s’ensuivre diverses aventures accompagnées de rumeurs, de secrets plus ou moins dévoilés, de coups de théâtre, d’idylles et de tragédies amoureuses, dans la tradition du drame populaire – d'où l’humour toutefois n’est pas absent, ne serait-ce que par le burlesque de certaines scènes, par la satire sociale ou par quelques plaisanteries teintées d’une misogynie à prendre au second degré. 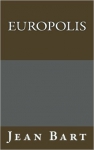 Europolis
Europolis Marius Daniel Popescu, Le cri du barbeau, éditions Corti, 2025
Marius Daniel Popescu, Le cri du barbeau, éditions Corti, 2025 Vintil
Vintil

 André Paléologue, Cécile Lauru. Le destin d’une compositrice française, de Nantes aux Carpates, Les cahiers de la société historique et archéologique des VIIIe et XVIIe arrondissements, numéro spécial, 2021.
André Paléologue, Cécile Lauru. Le destin d’une compositrice française, de Nantes aux Carpates, Les cahiers de la société historique et archéologique des VIIIe et XVIIe arrondissements, numéro spécial, 2021. Mais la rencontre de Vasile Georgescu Paleolog, le coup de foudre réciproque et le mariage changèrent l’orientation de sa vie. Son mari roumain, homme d’affaires, critique d’art, essayiste, était un ami de Constantin Brancuşi, spécialiste de son œuvre, et Cécile put ainsi fréquenter l’avant-garde de l’époque, artistes, hommes de lettres, musiciens, en particulier Erik Satie et le « groupe d’Arcueil ». « En 1921, selon les critères de l’époque, Cécile Lauru Paleolog était une femme comblée : mariée à un homme d’affaires de « bonne condition », mère de trois garçons en pleine forme, douée d’un potentiel créatif reconnu et admiré de son entourage… ». Elle suit son mari dans ses voyages professionnels, puis la famille part s’installer en Roumanie. Dépaysement total pour Cécile, qui va trouver une activité d’ethnomusicologue et continuer à créer, nourrissant ses compositions du « chant de l’Église orthodoxe » et du « folklore musical villageois », et qui durant cette période va composer, « dans un parfait esprit de liberté et de création », ses plus grandes œuvres. Puis c’est à nouveau Berlin pour l’éducation de ses enfants (1930-1940), l’expulsion par le régime nazi, le retour en Roumaine (Bucarest), avec « la musique comme dernier refuge » face aux brimades du régime totalitaire, la possibilité de revenir en France où elle meurt accidentellement en 1959.
Mais la rencontre de Vasile Georgescu Paleolog, le coup de foudre réciproque et le mariage changèrent l’orientation de sa vie. Son mari roumain, homme d’affaires, critique d’art, essayiste, était un ami de Constantin Brancuşi, spécialiste de son œuvre, et Cécile put ainsi fréquenter l’avant-garde de l’époque, artistes, hommes de lettres, musiciens, en particulier Erik Satie et le « groupe d’Arcueil ». « En 1921, selon les critères de l’époque, Cécile Lauru Paleolog était une femme comblée : mariée à un homme d’affaires de « bonne condition », mère de trois garçons en pleine forme, douée d’un potentiel créatif reconnu et admiré de son entourage… ». Elle suit son mari dans ses voyages professionnels, puis la famille part s’installer en Roumanie. Dépaysement total pour Cécile, qui va trouver une activité d’ethnomusicologue et continuer à créer, nourrissant ses compositions du « chant de l’Église orthodoxe » et du « folklore musical villageois », et qui durant cette période va composer, « dans un parfait esprit de liberté et de création », ses plus grandes œuvres. Puis c’est à nouveau Berlin pour l’éducation de ses enfants (1930-1940), l’expulsion par le régime nazi, le retour en Roumaine (Bucarest), avec « la musique comme dernier refuge » face aux brimades du régime totalitaire, la possibilité de revenir en France où elle meurt accidentellement en 1959. André Paléologue, historien, petit-fils de Cécile Lauru, était bien placé pour écrire l’histoire de cette musicienne trop méconnue, qui mérite amplement une réhabilitation, elle qui a tenté une « synthèse sonore européenne ». Son ouvrage, fortement documenté, illustré de photos probantes, raconte certes en détail la vie particulièrement remplie de sa grand-mère (qui soit dit en passant avait un caractère bien trempé), en s’appuyant en partie sur les 586 pages manuscrites de ses Souvenirs. Mais il va au-delà : il révèle tout un pan de la musique européenne du XXe siècle, sans se priver de faire quelques apartés, par exemple sur le piano qui a suivi la musicienne dans toutes ses pérégrinations, ni de poser quelques questions ou d’émettre quelques réflexions, par exemple sur la correspondance des arts (musique, littérature, peinture, sculpture…), ou sur le fait de savoir si l’on peut « circonscrire l’espace d’une musique spécifiquement roumaine » (question qui taraudait V. G. Paleolog), ou encore si l’on peut créer, comme le tenta Georges Enesco, une « musique moderne et nationale. » Ainsi, ces pages suscitent l’intérêt à plusieurs titres (biographique, musicologique, historique, critique), et mettent en lumière non seulement l’existence d’une grande figure artistique, mais beaucoup de questions relatives à la vie culturelle européenne.
André Paléologue, historien, petit-fils de Cécile Lauru, était bien placé pour écrire l’histoire de cette musicienne trop méconnue, qui mérite amplement une réhabilitation, elle qui a tenté une « synthèse sonore européenne ». Son ouvrage, fortement documenté, illustré de photos probantes, raconte certes en détail la vie particulièrement remplie de sa grand-mère (qui soit dit en passant avait un caractère bien trempé), en s’appuyant en partie sur les 586 pages manuscrites de ses Souvenirs. Mais il va au-delà : il révèle tout un pan de la musique européenne du XXe siècle, sans se priver de faire quelques apartés, par exemple sur le piano qui a suivi la musicienne dans toutes ses pérégrinations, ni de poser quelques questions ou d’émettre quelques réflexions, par exemple sur la correspondance des arts (musique, littérature, peinture, sculpture…), ou sur le fait de savoir si l’on peut « circonscrire l’espace d’une musique spécifiquement roumaine » (question qui taraudait V. G. Paleolog), ou encore si l’on peut créer, comme le tenta Georges Enesco, une « musique moderne et nationale. » Ainsi, ces pages suscitent l’intérêt à plusieurs titres (biographique, musicologique, historique, critique), et mettent en lumière non seulement l’existence d’une grande figure artistique, mais beaucoup de questions relatives à la vie culturelle européenne.  F. Brunea-Fox, de son vrai nom Filip Brauner, né en Moldavie en 1898 et mort en 1970, a dans sa jeunesse fréquenté l’avant-garde roumaine, avec notamment son ami B. Fundoianu qui deviendra Benjamin Fondane, puis s’est principalement consacré au journalisme avec des reportages dont l’ouvrage publié par les éditions Non Lieu donne un aperçu représentatif du style original de leur auteur, surnommé « le prince des reporters ». Cinq textes composent cet ouvrage : quatre reportages et un témoignage sous forme de journal en plusieurs parties qui donne son titre au volume, l’ensemble complété par un entretien accordé début 1970 par l’auteur au journaliste Carol Roman.
F. Brunea-Fox, de son vrai nom Filip Brauner, né en Moldavie en 1898 et mort en 1970, a dans sa jeunesse fréquenté l’avant-garde roumaine, avec notamment son ami B. Fundoianu qui deviendra Benjamin Fondane, puis s’est principalement consacré au journalisme avec des reportages dont l’ouvrage publié par les éditions Non Lieu donne un aperçu représentatif du style original de leur auteur, surnommé « le prince des reporters ». Cinq textes composent cet ouvrage : quatre reportages et un témoignage sous forme de journal en plusieurs parties qui donne son titre au volume, l’ensemble complété par un entretien accordé début 1970 par l’auteur au journaliste Carol Roman. Benjamin Fondane, Le mal des fantômes, édition établie par Patrice Beray et Michel Carassou avec la collaboration de Monique Jutrin. Liminaire d’Henri Meschonnic, Non Lieu /
Benjamin Fondane, Le mal des fantômes, édition établie par Patrice Beray et Michel Carassou avec la collaboration de Monique Jutrin. Liminaire d’Henri Meschonnic, Non Lieu / Cahiers Benjamin Fondane
Cahiers Benjamin Fondane Le Persil Journal
Le Persil Journal Ana Blandiana, Poèmes résistants, traduits du roumain par Hélène Lenz, édition bilingue révisée et présentée par Jean Poncet, Jacques André éditeur, 2024
Ana Blandiana, Poèmes résistants, traduits du roumain par Hélène Lenz, édition bilingue révisée et présentée par Jean Poncet, Jacques André éditeur, 2024 Dumitru Tsepeneag, Mise en scène, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2024
Dumitru Tsepeneag, Mise en scène, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, P.O.L., 2024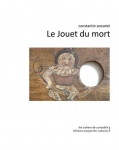 Constantin Acosmei, Le Jouet du mort, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, éditions Marguerite Waknine, coll. Les cahiers de curiosités, 2024
Constantin Acosmei, Le Jouet du mort, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, éditions Marguerite Waknine, coll. Les cahiers de curiosités, 2024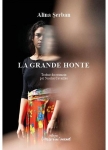 Alina Şerban, La Grande Honte, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, éditions L’espace d’un instant, 2024
Alina Şerban, La Grande Honte, traduit du roumain par Nicolas Cavaillès, éditions L’espace d’un instant, 2024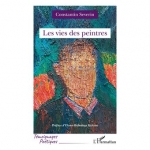 Depuis le poème « Correspondances » de Baudelaire (entre autres références), il est souvent question de synesthésies en matière artistique, et c’est tant mieux, car l’art est le meilleur moyen de solliciter simultanément tous les sens, ou plusieurs d’entre eux. Voilà ce qui se passe dans le beau recueil poétique de Constantin Severin, lui-même artiste, fondateur de « l’Expressionnisme archétypal », mouvement qui se réfère à des créations de diverses époques.
Depuis le poème « Correspondances » de Baudelaire (entre autres références), il est souvent question de synesthésies en matière artistique, et c’est tant mieux, car l’art est le meilleur moyen de solliciter simultanément tous les sens, ou plusieurs d’entre eux. Voilà ce qui se passe dans le beau recueil poétique de Constantin Severin, lui-même artiste, fondateur de « l’Expressionnisme archétypal », mouvement qui se réfère à des créations de diverses époques.