 Liliana Lazar, Enfants du diable, Le Seuil, 2016
Liliana Lazar, Enfants du diable, Le Seuil, 2016
Dans les années 1970-1980, la politique nataliste de Ceauşescu faisait des ravages : avortements clandestins, accouchements sous x, abandons d’enfants qui venaient remplir les orphelinats sordides. Dans ce contexte, Elena Cosma, sage-femme à Bucarest, célibataire en mal d’enfant, décide d’adopter le bébé de Zelda, l’une de ses patientes, avec l’accord de celle-ci. Au bout de quelque temps, Zelda devenant trop pressante auprès de l’enfant, Elena décide de demander sa mutation et de partir avec lui pour un « voyage sans retour » à l’autre bout du pays, dans un village de Moldavie, Prigor.
À partir de là, les événements vont s’enchaîner rapidement. Le petit Damian, « enfant de Dieu », dont la beauté fragile ne rappelle en rien la physionomie robuste de sa « mère », et sur lequel courent diverses rumeurs, devient le souffre-douleur de ses camarades, tandis qu’Elena, la seule soignante du village, remplit le mieux possible sa mission d’infirmière pour une population dominée par la frayeur qu’inspire le « Despote » Miron Ivanov, maire du village. Désireuse d’étendre son activité, et aussi de se couler dans le moule politico-social de l’époque tout en gardant son secret familial, Elena propose aux autorités de créer un orphelinat à Prigor. L’établissement, installé dans une forêt à l’écart du village, est comme toutes les « maisons d’enfants » du pays un enfer pour ses pensionnaires, appelés (par allusion à leur « père » à tous, Ceauşescu) « enfants du diable »), qui survivent tant bien que mal (et parfois meurent) sous la férule des surveillants, mal nourris, privés de l’hygiène élémentaire et de tout ce qui fait les petits bonheurs habituels des enfants. Certains orphelins, issus du village, sont au cœur des mystères qui tournent autour d’Elena, de Damian, du maire Ivanov – et c’est ainsi que l’intrigue se faufile entre la réalité dramatique de cette période et les personnages lourds de leurs souffrances, de leurs silences, de leurs relations ambiguës, de leurs résignations et de leurs révoltes.
Le récit foisonnant, mené d’une plume alerte et vigoureuse, court sur une bonne dizaine d’années. À travers les histoires individuelles et au-delà des profondeurs mystérieuses que recèlent les personnages, les événements et les lieux (le village reculé, la forêt, l’étang – motifs que l’on trouvait déjà dans Terre des affranchis), c’est aussi l’histoire de la Roumanie qui se déroule : la dictature, les malheurs de la population, surtout des enfants, la catastrophe de Tchernobyl dont le retentissement est clairement sensible, la « révolution » de fin 1989, l’apparition des « humanitaires », qui traînent eux aussi leurs ambiguïtés… Roman à la fois historique, social, psychologique, noir, Enfants du diable mêle avec bonheur la réalité et l’imaginaire, la narration sèche et les mystères de la poésie. Belle manifestation d’une écriture combinant la maîtrise consommée de la langue française et la perpétuation d’un certain esprit roumain.
Jean-Pierre Longre
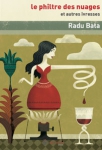
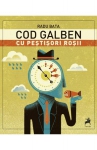 Mais comment préserver la sincérité du cœur dans un monde où « les humains ne savent plus dire qu’amour de soi », dans un monde où les « enfants battus / de la prospérité » doivent fraterniser avec des « loups-garous avares » ou des « vampires malveillants » ? Comment l’individu, condamné à « vivre pluvieux », peut-il affronter les monstres modernes ? Radu Bata n’a pas perdu ses racines roumaines, qu’il revendique çà et là, et n’a rien oublié non plus de la beauté des nuages, de « l’harmonie cosmique », de la « langue du doute », des bienfaits du silence, ni de l’ivresse que procure la vraie poésie, celle de Rimbaud ou de Nichita Stanescu par exemple.
Mais comment préserver la sincérité du cœur dans un monde où « les humains ne savent plus dire qu’amour de soi », dans un monde où les « enfants battus / de la prospérité » doivent fraterniser avec des « loups-garous avares » ou des « vampires malveillants » ? Comment l’individu, condamné à « vivre pluvieux », peut-il affronter les monstres modernes ? Radu Bata n’a pas perdu ses racines roumaines, qu’il revendique çà et là, et n’a rien oublié non plus de la beauté des nuages, de « l’harmonie cosmique », de la « langue du doute », des bienfaits du silence, ni de l’ivresse que procure la vraie poésie, celle de Rimbaud ou de Nichita Stanescu par exemple.
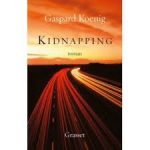 Gaspard Koenig, Kidnapping, Grasset, 2016
Gaspard Koenig, Kidnapping, Grasset, 2016  Visiblement, Gaspard Koenig maîtrise son sujet et l’art du roman. La vie londonienne avec ses rites et ses clivages sociaux, la Roumanie dans sa diversité, Bucarest, son animation et ses excès, les campagnes profondes, les monastères et leurs traditions (certains clichés tenaces aussi), les ambitions souvent restées lettre morte des instances européennes, les péripéties que les confrontations entre ces univers entraînent, les traits satiriques auxquels peu échappent : tout est réuni pour procurer une lecture à la fois rebondissante et documentée, qui n’exclut pas la réflexion sur la marche économique du monde et les dissensions qu’elle induit au sein de l’Europe. Un simple échange entre David le banquier de la City et Veronica la bibliothécaire du monastère de Varatec résume parfaitement l’incompréhension réciproque : « Avec l’autoroute, la croissance du département de Neamt devrait attendre les 5% par an. – La croissance de quoi, mon fils ? ». Kidnappeur, kidnappé, les rôles ne sont pas définitivement distribués…
Visiblement, Gaspard Koenig maîtrise son sujet et l’art du roman. La vie londonienne avec ses rites et ses clivages sociaux, la Roumanie dans sa diversité, Bucarest, son animation et ses excès, les campagnes profondes, les monastères et leurs traditions (certains clichés tenaces aussi), les ambitions souvent restées lettre morte des instances européennes, les péripéties que les confrontations entre ces univers entraînent, les traits satiriques auxquels peu échappent : tout est réuni pour procurer une lecture à la fois rebondissante et documentée, qui n’exclut pas la réflexion sur la marche économique du monde et les dissensions qu’elle induit au sein de l’Europe. Un simple échange entre David le banquier de la City et Veronica la bibliothécaire du monastère de Varatec résume parfaitement l’incompréhension réciproque : « Avec l’autoroute, la croissance du département de Neamt devrait attendre les 5% par an. – La croissance de quoi, mon fils ? ». Kidnappeur, kidnappé, les rôles ne sont pas définitivement distribués…